Introduction
Le déclin démographique est une cause d’inquiétude pour les jeunes du Québec. On anticipe déjà ses effets sur les finances de l’Etat et sur les services publics. Il aura pourtant des effets beaucoup plus larges, des effets qui se font déjà sentir sur le marché du travail puisque les jeunes âgés entre 15 et 34 ans ont diminué en nombre et en proportion de la population. Jusqu’à présent, malgré tout, l’emploi se porte bien et l’économie du Québec connaît de belles années. De l’autre côté de la pyramide des âges, les départs à la retraite des baby-boomers sont bien souvent présentés comme une perspective positive pour les jeunes qui pourraient combler les postes laissés vacants. Il se pourrait même que d’éventuelles pénuries de main d’œuvre spécialisées fassent grimper les salaires. Mais qu’en sera-t-il vraiment ?
Pour estimer l’évolution possible du marché du travail dans les années à venir, nous nous pencherons d’abord sur la situation économique des jeunes et son évolution depuis les dernières décennies. La scolarité la détermine en grande partie. Mais les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler parallèlement à leurs études. Par conséquent, l’insertion professionnelle des jeunes est un long processus, s’étalant parfois sur de nombreuses années, où les études et l’insertion professionnelle s’entrecroisent.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux conditions d’emploi actuelles des jeunes et à leur évolution. Le travail atypique et ses statuts d’emplois précaires retiendront particulièrement notre attention ainsi que les salaires. L’expérience, un facteur important en matière de condition d’emploi, sera indirectement traitée à l’aide de quelques données sur l’évolution de la durée de l’emploi.
Dans le dernier chapitre, les tendances analysées nous permettront d’appréhender l’évolution possible du marché du travail dans les années à venir. Les nombreux déterminants de l’emploi qui sont à l’œuvre ne facilitent pas cette tâche. Néanmoins, l’évaluation prospective du marché du travail, marquée par l’omniprésente question démographique, permet d’envisager les perspectives d’emploi des jeunes.
Remarques méthodologiques
Le présent rapport s’intéresse à la situation des jeunes sur le marché du travail. Ce thème très large obligeait certains choix, car les causes, les manifestations et les conséquences des différentes facettes de la situation des jeunes sur le marché du travail pouvaient être innombrables. Ainsi, les aspects plus sociaux du marché du travail sont délaissés pour une approche plus économique de la question. Bien que partielle, cette approche permet tout de même de saisir plusieurs nuances et de poser des constats pertinents. Parmi les multiples conditions d’emploi envisageables, ce sont surtout les statuts d’emploi et les salaires qui ont retenu notre attention. Les régimes de retraites, l’épargne personnelle, les assurances collectives, la santé et la sécurité au travail, ou encore les trajectoires d’emploi seront peu ou pas abordés. La plupart de ces choix respectent cependant le mandat de cette recherche.
Dans le même ordre d’idée, la littérature existante et les données disponibles ont aussi limité nos analyses dans une certaine mesure. La plupart des textes consultés sont suffisamment récents pour conserver leur pertinence sur un thème où de nouvelles données apparaissent sans cesse. Quelques ouvrages plus anciens semblaient adéquats lorsque venaient le temps de tracer les tendances ayant marqué les dernières décennies du marché du travail. Lorsque cela était possible, les analyses des auteurs ont été actualisées. Parfois, de nouvelles analyses étaient nécessaires. À cette fin, les bases de données de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec ont été fort utiles. Parfois, il a fallu se résoudre à ne couvrir que les trente dernières années puisque le nombre de séries de données ne débutent qu’en 1976. Certaines ne couvrent que les sept dernières années, ce qui ne permet pas de dégager des tendances consistantes. D’autres données n’étaient disponibles que pour le Canada dans son ensemble. Celles qui sont néanmoins présentées semblaient n’être pas trop éloignées du contexte québécois. Enfin, pour ce qui est du découpage en fonction des groupes d’âge, nous avons bénéficié de l’apport d’Emploi-Québec qui nous a fourni des compilations spéciales. Nous les en remercions. Il nous faut aussi remercier spécialement Guylaine Baril, du CETECH, pour ses commentaires extensifs ayant permis de corriger de nombreuses impropriétés.
En définitive, les statistiques occupent une place prépondérante dans ce rapport de recherche. Sa lecture n’en est pas facilitée, mais toutes ces données permettent de consulter les parties de ce rapport jugées les plus pertinentes et d’avoir rapidement un portrait juste des perspectives et conditions d’emploi des jeunes du Québec.
Chapitre 1 : La situation économique des jeunes
Le Québec compte, en 2005, environ 7 566 000 habitants dont 6 310 000 sont âgés de 15 ans et plus [1] , soit la population ayant l’âge de travailler. Parmi ces derniers, les 15-24 ans sont 958 428, soit 15,2 % des 15 ans et plus, et les 25-34 ans sont 1 008 000, soit 16,0 % des 15 ans et plus. En 1976, les 15-24 ans étaient au nombre de 1 311 000, parmi 4 758 200 personnes âgées de 15 ans et plus et représentaient ainsi 27,6 % des individus en âge de travailler. Comme le fait remarquer André Grenier, d’Emploi-Québec, « En 30 ans, la part des jeunes dans la population de 15 à 64 ans aura diminué de moitié [2] » . Ainsi, la réalité du déclin démographique du Québec est-elle déjà bien présente dans les plus jeunes générations, qui déclinent non seulement en proportion de la population totale, mais aussi de façon absolue puisqu’elles comptent moins d’individus qu’il y trente ans.
Cette réalité démographique se traduit dans la population active comme dans la population en emploi, comme l’illustrent les graphiques suivants.
On constate en effet la décroissance absolue et relative des jeunes de 15 à 24 ans dans la population active et dans la population en emploi. Pour ce qui est de la population active, une partie de la décroissance est sans doute le résultat de l’allongement de la scolarité puisque les étudiants ne sont pas comptés dans la population active. On voit toutefois que la population en emploi reflète le même phénomène, ces variations influençant davantage l’évolution des 15 ans et plus que dans le cas de la population active. En fait, la diminution des 15-24 ans dans la population active, du sommet de 829 400 en 1980 au creux de 542 600 en 1997, représente une diminution de 34,6 %. Dans le cas de l’emploi, entre le sommet de 690 200 en 1980 et le creux de 437 800 en 1997, la diminution est de 36,6 %, deux points de pourcentage de plus que dans la population active.
Cette évolution marque certainement la place des jeunes dans le marché du travail. Mais les conséquences en sont incertaines. Nous reviendrons sur cette question, dans un cadre prospectif, dans le chapitre 3. Pour l’instant, nous nous contenterons de retenir que les jeunes occupent moins de place dans le marché du travail suite à une diminution presque continue entre 1980 et 1997. Ce phénomène reprendra éventuellement comme en témoignent les projections démographiques actuelles.
En considérant ces dernières années, on constate aussi que le marché du travail québécois s’améliore en comparaison avec la moyenne canadienne au chapitre du taux d’emploi, ce qu’illustrent les graphiques 1.0.3 et 1.0.4 suivants.
Pour ce qui est des taux d’emploi, tous les niveaux de scolarité confondus, le rattrapage des 15-24 ans a été particulièrement marqué après 1997. Leur taux d’emploi est même meilleur au Québec en 2003. Le rattrapage a été plus graduel pour les 25-54 ans, mais leur taux d’emploi en est tout de même à plus de 98 % du taux moyen canadien.
Le graphique 1.0.4 montre cependant que les taux d’emploi des diplômés postsecondaires souffrent encore d’un certain retard, surtout pour les 15-24 ans. Mais à 97 % de la moyenne canadienne en 2003, le rattrapage par rapport au niveau de 1990 demeure substantiel. Ces données montrent la vitalité économique québécoise, une situation conjoncturelle pouvant camoufler les difficultés structurelles des jeunes.
Dans ce chapitre, nous couvrirons quelques phénomènes qui marquent la transition des jeunes de l’école au marché du travail. Le parcours scolaire des jeunes sera notre point de départ puisque la scolarité elle-même constitue un facteur primordial conditionnant en bonne partie la vie active des futurs travailleurs. Par la suite, le travail étudiant retiendra notre attention. Ce phénomène a en effet connu un essor impressionnant ces dernières années et, de plus, il s’agit bien souvent d’un premier contact avec le marché du travail pour bon nombre de jeunes. Comme le souligne Madeleine Gauthier, chercheure à l’Observatoire Jeunes et société de l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC), les jeunes prennent un travail durant leurs études de plus en plus tôt, et accède à un emploi permanent de plus en plus tard [3] . Enfin, l’insertion professionnelle des jeunes demeure largement marquée par le chômage, phénomène qui sera traité à la fin de ce chapitre.
1.1 Le parcours scolaire des jeunes
Le parcours scolaire des jeunes est une donnée primordiale à étudier pour caractériser les perspectives et les conditions d’emploi des jeunes, d’une part parce que nombre de jeunes poursuivent des études et d’autre part, parce que le niveau de scolarité atteint détermine dans une large mesure l’insertion professionnelle des individus. Par ailleurs, certains combinent les études et le travail, mais nous reviendrons sur le thème du travail étudiant dans la section suivante de ce chapitre.
L’augmentation de la fréquentation scolaire et le décrochage
Les dernières décennies ont été marquées par une croissance phénoménale de la fréquentation scolaire. Tant à la scolarité obligatoire que dans les études plus poussées, les effectifs scolaires se sont multipliés. La fréquentation accrue des femmes a participé à cette croissance, tant et si bien qu’elles sont aujourd’hui plus nombreuses que les hommes, même à l’université. À l’inverse, nombre de jeunes hommes décrochent de leur parcours scolaire, bien que le phénomène du décrochage ne leur soit pas exclusif.
Madeleine Gauthier souligne ainsi l’allongement de la scolarisation : en 1961, 7 % des 20-24 ans étaient étudiants alors que c’était le cas de 50 % d’entre eux en 1996 [4]. En effet, poursuivre des études au-delà du secondaire est considéré aujourd’hui comme banal, mais ce n’était pas nécessairement le cas avant la révolution tranquille. Pierre Chénard, pour sa part, souligne la croissance phénoménale des études aux cycles supérieurs : « [les effectifs étudiants] des cycles supérieurs ont presque triplé depuis 1970, alors que ceux du premier cycle ont augmenté d’un peu moins de deux fois et demi leur volume initial [5] ». Pour illustrer le parcours scolaire constaté actuellement, le tableau en annexe montre le parcours d’une cohorte de cent étudiants en 2003-2004.
L’augmentation de la fréquentation scolaire des dernières décennies provient dans une large mesure du rattrapage impressionnant des jeunes femmes sur ce plan : « Alors qu’elles [les femmes] ont longtemps été minoritaires, elles comptaient pour 57 % de la clientèle universitaire en 1995. Cela est vrai pour les premier et deuxième cycle [59 % et 51 %], toutefois au troisième cycle, elles ne représentent encore que 40 % de la clientèle [6] ». Ce rattrapage s’est d’abord fait par les filières associées à des champs d’études « féminins » avant de se généraliser : « Ainsi, les femmes ont d’abord été présentes au premier cycle et dans des secteurs traditionnellement féminins, tels que l’éducation et les sciences infirmières. Aujourd’hui, au premier cycle, les femmes sont devenues majoritaires dans tous les secteurs, à l’exclusion de ceux des sciences pures, où elles représentent un peu moins de la moitié des effectifs, et de celui des sciences appliquées, où elles demeurent encore nettement minoritaires [17 % en 1995] » [7]. Dans l’ensemble, toutefois, les différences entre les hommes et les femmes ne devraient plus connaître des écarts tels que ceux des années 60.
Sur le plan international, le Québec se trouve en bonne posture en termes de diplômés universitaires parmi sa population, selon le Centre d’étude sur l’emploi et la technologie, ou CETECH [8]. Il devance même la plupart des pays d’Europe, mais se situe sous la moyenne canadienne [9]. Par contre, les comparaisons internationales au chapitre de la diplomation secondaire sont moins reluisantes, soulignant les difficultés du Québec aux prises avec un décrochage élevé.
L’accroissement de la scolarité crée cependant une demande toujours accrue de diplômes. L’inflation des titres scolaires, sur laquelle nous reviendrons au chapitre 3, décrit les attentes de plus en plus élevées des employeurs quant à la scolarité de leurs futurs employés, même lorsque ces attentes ne correspondent pas à la formation nécessaire pour les emplois offerts. Par effet d’entraînement, ou de tassement, des postes qui exigeaient auparavant moins de formation scolaire sont désormais occupés par des diplômés à la scolarité élevée. En bref, la croissance des effectifs scolaires entraîne des demandes accrues de la part des employeurs et consacre en quelque sorte l’obligation d’une scolarité poussée pour les jeunes désirant se trouver du travail étant donnée la force de la compétition. En conséquence, dans une société très scolarisée, le décrochage scolaire devient qualitativement plus problématique. Nous croyons que c’est actuellement le cas, du moins, davantage que par le passé. En effet, comme le souligne le Conseil supérieur de l’éducation, « ne pas avoir de diplôme handicape plus encore aujourd’hui qu’autrefois » [10]. La forte présence de la problématique du décrochage dans la sphère publique traduit aussi, selon nous, l’importance désormais accordée dans le processus d’insertion professionnelle à la poursuite des études.
Or, les jeunes Québécois sont nombreux à décrocher à un moment ou à un autre de leur parcours scolaire. Il est difficile de comparer les taux de décrochage actuels avec des taux antérieurs, notamment parce que les exigences académiques varient dans le temps, en plus de la valeur qualitative de l’éducation soulignée précédemment qui varie aussi. Vultur et al. nous rappellent toutefois que le taux de sortie sans diplôme [11] a connu une hausse de 1985-1986 jusqu’au début des années 90 suite à « l’élévation de la note de passage de 50 % à 60 % [et à] l’ajout d’une année de formation générale préalable à l’inscription à des filières d’enseignement professionnel [12] » . Après avoir décliné, il a augmenté de nouveau entre 1997 et 1999-2000, année où 28,7 % des élèves n’avaient pas obtenu leur diplôme d’études secondaires « au secteur des jeunes ou avant l’âge de 20 ans au secteur des adultes » [13]. Le taux de décrochage des 19 ans est passé, quant à lui, de 40,5 % en 1980 à 19,8 % en 2000 [14]. Même après cette diminution de moitié en vingt ans, il demeure supérieur à la moyenne canadienne.
Le tableau 1.1.1 donne un portrait de la diplomation par région, étant donné les difficultés particulièrement épineuses de certaines régions comparées à l’ensemble du Québec, ainsi que par sexe puisque les jeunes hommes sont généralement plus sujets au décrochage.
Ce tableau donne une idée du décrochage en considérant que les élèves n’ayant pas obtenu de diplôme après sept ans, s’ils ne fréquentent plus l’école, sont des décrocheurs. Mais l’intérêt de ces données est aussi de démontrer que si la diplomation s’améliore lorsqu’on ne considère pas seulement la durée « normale » des études secondaires, elle demeure très faible après cinq ans. Force est de constater que nombreux sont les jeunes qui retardent leur diplomation.
Le tableau 1.1.2 présente pour sa part le taux de sortie sans diplôme pour la dernière année scolaire pour laquelle les données étaient disponibles.
Entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean (avec 15,6 %) et le Nord-du-Québec (59,3 %), on constate l’incroyable disparité régionale en matière de « décrochage ». Par ailleurs, il peut être intéressant de remarquer que la plupart des régions éprouvant les difficultés les plus prononcées sont des régions centrales du Québec, à l’exception notable de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Il est possible que dans ces régions, dont la population scolaire et souvent concentrée dans des milieux plus urbains, les jeunes fassent face à un contexte ou à des difficultés différents des milieux ruraux, comme des opportunités d’emploi en restauration ou en vente représentant des gains financiers à court terme mais qui amenuisent leur persévérance scolaire.
Notons que la diplomation et le décrochage ne sont pas l’apanage du niveau secondaire. Pour le niveau collégial, le taux de sortie sans diplôme est plus élevé dans les formations techniques (45,2 % en 1998-1999) que les formations préuniversitaires (29,9 % la même année) [15]. Dans l’article Les jeunes québécois sans diplôme, on souligne aussi le fait que parmi les diplômés, un bon nombre prend aussi davantage que les délais prescrits pour compléter leur formation. Le décrochage à l’université semble souvent moins choquant étant donné que les décrocheurs détiennent déjà souvent un diplôme d’étude postsecondaire.
Bien que les comparaisons historiques des taux de décrochage ou de sortie sans diplôme soient risquées, André Grenier souligne que ce phénomène s’est atténué au cours des dernières décennies : « L’augmentation importante de la fréquentation scolaires chez les jeunes et la réduction, d’une part, de la proportion de jeunes sous-scolarisés ainsi que la forte augmentation, d’autre part, du nombre de détenteurs d’un diplôme d’études postsecondaires ou universitaires remettent dans une plus juste perspective le discours sur le décrochage scolaire des jeunes. Si celui-ci demeure un sujet de préoccupation importante, il ne semble pas être un phénomène en voie d’aggravation, au contraire » [16] . Ce constat, remarquons-le, porte sur le nombre de détenteurs de diplôme. Or, nombreux sont les décrocheurs qui terminent leur diplôme d’études secondaires, pour donner cet exemple, à l’éducation des adultes plutôt qu’à l’enseignement régulier. Ces parcours considérés comme inhabituels pour les étudiants les plus jeunes remettent néanmoins en question, à notre humble avis, la capacité du parcours régulier de répondre aux réalités des jeunes. Sans jeter toute la faute à l’école, il demeure qu’ « une sortie sans diplôme est normalement le signe que les apprentissages requis pour son obtention n’ont pas été réalisés et que l’école, pour des raisons internes ou des motifs qui lui échappent, n’est pas parvenue à faire accomplir au jeune ces apprentissages » [17].
Le décrochage sans diplôme n’est jamais définitif et chaque jeune décrocheur peut toujours obtenir son diplôme plus tard. Toutefois, en considérant la situation des 25-29 ans, on peut en grande partie constater la finalité des parcours scolaires. C’est ce qu’a fait André Grenier. En 1997, 16 % de ce groupe d’âge ne détenait toujours pas de diplôme d’études secondaires, soit 19 % des hommes et 14 % des femmes. De plus, 9 % avait interrompu leurs études avant d’avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires. D’autre part, 13 % détenait un diplôme d’études secondaires, 40 % un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires et 22 % un diplôme universitaire. Dans ce dernier cas, on observe aussi un bon écart entre les sexes, soit 19 % pour les hommes et 25 % pour les femmes. D’ailleurs, il semble que « l’écart entre les sexes [ait], depuis 1975, une tendance à la hausse [18] ». Le graphique suivant illustre les données sans distinction de sexe.
Si le taux de décrochage des 25-29 ans est de 16 % selon ces données, il demeure néanmoins significatif qu’un jeune sur quatre ait interrompu ses études en cours de route. Ainsi, non seulement une partie des jeunes terminent-ils leurs études avec du retard, d’autres ayant recours à la formation offerte au secteur des adultes, mais en bout de ligne, nombreux sont les jeunes n’ayant pas complété un projet d’étude dans lequel ils s’étaient pourtant engagés. Il s’agit là, à notre avis, d’un constat significatif pour les perspectives futures du Québec.
Cette description du décrochage scolaire donne donc un portrait somme toute nuancé du phénomène. L’augmentation de la fréquentation scolaire et la bonne position du Québec dans le monde pour ce qui est des diplômés universitaires dans sa population montrent qu’il existe bien certaines réussites. Cependant, plusieurs éléments indiquent que le décrochage scolaire et la non-diplomation sont toujours inquiétants, qu’ils posent de graves questions à notre système scolaire actuel et qu’il y a lieu de s’inquiéter lorsqu’on réalise l’importance qualitative du décrochage. Nous aborderons dans les pages suivantes les nombreux liens entre la scolarité et l’insertion professionnelle, un portrait qui permettra aussi d’apprécier les conséquences du décrochage.
Emploi et chômage en fonction de la scolarité et de la diplomation
Pour comprendre les liens entre la scolarité et l’emploi, les tableaux suivants illustrent le cas des 25-34 ans qui occupent un emploi, ventilés par le plus haut niveau de scolarité atteint. Le choix de considérer les 25-34 ans relève de la volonté de constater la situation de jeunes ayant souvent terminé leurs études. L’évolution de la scolarité entre 1990 et 2004 montre bien la hausse de la scolarisation des jeunes en emploi.
Pour tous les niveaux de scolarité inférieurs aux études postsecondaires partielles, la proportion des 25-34 ans occupant un emploi est en diminution. Les diplômés du postsecondaire, collégiaux ou universitaires, voient quant à eux leurs proportions augmenter.
La question qui se pose naturellement en regard de ces données est de savoir si cette évolution provient de l’augmentation de la scolarité ou si elle s’explique plutôt par le fait que les emplois deviennent plus sélectifs à l’égard de la scolarité. Le tableau donnant le niveau de scolarité des jeunes de 25-34 ans en emploi, en milliers, donne une partie de la réponse. Les jeunes sont de plus en plus nombreux en absolu à poursuivre des études plus poussées, comme c’est aussi le cas pour les pourcentages qui donnent un portrait relatif. Par contre, les tableaux 1.1.4 et 1.1.5 illustrant l’évolution du taux de chômage et du taux d’emploi selon le plus haut niveau de scolarité atteint sont plus ambigus. Ils démontrent généralement qu’il est de plus en plus facile de se trouver un emploi peu importe la scolarité lorsqu’on compare la situation de 2004 avec celle de 1995. Ces neuf années ont été marquées par une croissance économique et une réduction du chômage appréciables. Il semble que le contexte éminemment favorable ait ainsi profité à tous. Ainsi, si tous peuvent trouver du travail plus aisément indépendamment de leur niveau de scolarité, et puisque les jeunes acquièrent une scolarité plus poussée en moyenne, on peut en conclure que c’est essentiellement la progression de la scolarité qui explique l’évolution de la scolarité des jeunes en emploi.
Un second constat important est l’effet de l’augmentation de la scolarité sur le taux de chômage et le taux d’emploi. Le graphique 1.1.2 suivant compare le taux de chômage des 15-24 ans cette fois, selon leur niveau de scolarité et en comparaison des 25-54 ans, tous les niveaux de scolarité confondus. Ce graphique est construit de telle sorte que, par exemple, un écart de 100 % indique que le taux de chômage est le double de celui du groupe de référence alors qu’un écart nul signifie que les taux de chômage des deux groupes d’âge sont identiques.
Ce graphique illustre nettement que plus la scolarité est élevée, moins le taux de chômage comporte d’écart avec le groupe de référence. Les détenteurs de baccalauréats ont même eu un taux de chômage généralement inférieur aux 25-54 ans durant cette période. Plus encore, cet écart est de moins en moins volatile lorsque la scolarité progresse. Enfin, les jeunes ayant terminé des études postsecondaires ou de baccalauréat ne voient pas leurs écarts augmenter par rapport au groupe de référence, contrairement aux jeunes moins scolarisés pour qui la situation s’est détériorée durant les dix dernières années.
Cette corrélation entre scolarité et chômage est aussi corroborée par les données provenant de la relance des diplômés, effectuée par le MEQ deux ans après la fin des études. Le graphique 1.1.3 ci-dessous témoigne de la diminution du taux de chômage au fur et à mesure que la scolarité augmente. La transition entre les diplômés secondaires et collégiaux est particulièrement impressionnante, le taux de chômage chutant de moitié. Le doctorat représente quant à lui une exception un peu énigmatique.
Outre l’évolution à la hausse de la scolarisation et ses effets positifs sur le taux d’emploi et le taux de chômage, un troisième constat doit retenir notre attention. Il s’agit de l’importance de la diplomation. Les travaux de Madeleine Gauthier sur cette question sont significatifs. Elle compare la situation des diplômés et des non-diplômés du secondaire et du postsecondaire pour les années 1990 et 2000, comme en témoigne le tableau 1.1.6.
Les constats que l’auteure tire de cette comparaison sont édifiants. En matière de taux d’activité et de taux d’emploi, les diplômés du postsecondaire sont avantagés par rapport à leurs collègues, de même que les non-diplômés par rapport à leurs équivalents au secondaire. Par ailleurs, l’écart entre diplômés et non-diplômés est plus important au niveau secondaire que postsecondaire. Enfin, ces tendances se retrouvent généralement en 1990 comme en 2000, sauf pour les diplômés des deux niveaux qui partageaient les mêmes taux d’activité (76,6 % au secondaire contre 76,4 % au postsecondaire) et des taux d’emploi similaires (66,5 % au secondaire contre 68,8 % au postsecondaire). Il faut aussi voir que les taux d’activité et les taux d’emploi étaient généralement plus élevés en 1990 que récemment, sauf pour les diplômés postsecondaires.
Les parts de l’emploi à temps partiel se distinguent des taux d’emploi pour l’année 2000. D’une part, les diplômés des deux niveaux partagent des situations quasi identiques. Les non-diplômés travaillent davantage à temps partiel, en particulier ceux du postsecondaire. Il est possible que cette différence s’explique par une expérience professionnelle plus substantielle pour les non-diplômés secondaires.
En termes de chômage, non seulement retrouve-t-on des taux plus bas pour le postsecondaire, mais on constate aussi d’importants écarts entre les taux des diplômés et ceux des non-diplômés (un écart de 7,6 points de pourcentage au secondaire et de 5,1 points de pourcentage au postsecondaire, en 2000), écarts toujours à l’avantage des diplômés. En 1990, les taux de chômage étaient toutefois fort semblables entre diplômés et non-diplômés du postsecondaire, et l’écart entre les taux de chômage des diplômés et non-diplômés du secondaire était moindre alors (5,2 points de pourcentage au lieu de 7,6).
Ainsi, si l’accroissement de la scolarité est un facteur crucial en termes d’insertion professionnelle, la diplomation aussi améliore la situation des jeunes, tant en matière de taux d’activité, de taux d’emploi ou de taux de chômage qu’en matière d’emploi à temps plein. On voit là toute l’importance de la scolarité comme préparation au marché du travail, d’autant plus que les effets de la scolarité ne se limitent pas à diminuer le taux de chômage ou à augmenter le taux d’emploi.
La diplomation détermine aussi l’insertion professionnelle. Le tableau 1.1.7 donne plus précisément le taux de chômage suivant les études selon le diplôme décroché. Il est intéressant de constater que le taux de chômage propre à chaque type de diplôme est inférieur au taux de chômage moyen des 15-24 ans. On observe aussi dans ce tableau une très importante amélioration du taux de chômage entre les diplômes professionnels au secondaire et les diplômes techniques au collégial. Cet écart dans les taux de chômage est plus important quantitativement entre le secondaire et le collégial qu’entre le collégial et le baccalauréat.
En somme, l’accroissement de la scolarité des jeunes en emploi est un signe encourageant et d’autant plus important que l’influence de la scolarité sur le taux de chômage et le taux d’emploi est claire, tout comme l’influence de la diplomation. Les impacts de la scolarité sur les perspectives professionnelles des jeunes ne se limitent toutefois pas à la possibilité ou non de se trouver un emploi.
Les effets de la scolarité sur la situation en emploi
La scolarité influence d’autres aspects de la situation professionnelle pour les jeunes qui ont un emploi. Nous ne traiterons ici que des effets de la scolarité, puisque les conditions générales d’emploi des jeunes font l’objet du chapitre suivant. Il sera question ici du salaire, du lien entre la formation et l’emploi occupé, de la satisfaction par rapport au travail, ainsi que de la capacité de faire des projets à long terme. La relance des diplômés effectuée par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) atteste d’un certain nombre de ces effets.
Ainsi, on observe que certaines formations, même si elles peuvent conduire au marché du travail, amènent les diplômés à poursuivre leurs études, particulièrement le DEC technique et le baccalauréat. Les formations professionnelles offertes au secondaire, au contraire, débouchent moins souvent sur d’autres études. Comme il fallait s’y attendre, les diplômés universitaires choisissent de moins en moins de poursuivre plus loin leur formation lorsque leur niveau de scolarité s’élève et intègrent de plus en plus le marché du travail.
Les emplois obtenus par les diplômés sont fréquemment à temps plein (entre 86,3 % et 91,2 %). Les différences entre niveaux sont ici plutôt faibles. Par contre, le lien entre l’emploi et la formation augmente avec la scolarité. Il est possible que le temps investit dans une formation amène les diplômés à vouloir travailler d’abord et avant tout dans leur domaine, comme l’affirme Marie-Claude Gagnon : « Après avoir investi dans leurs études, certains diplômés et diplômées voudraient avoir définitivement les outils pour un travail professionnel dans leur domaine d’études » [19] . Ce qui pourrait aussi expliquer la croissance de la durée de recherche d’emploi dans les formations plus longues.
L’influence de la scolarité sur le salaire, quant à lui, est bien visible. Les formations universitaires permettent des attentes salariales plus élevées, particulièrement le baccalauréat (10 816$ de plus annuellement que le DEC technique) et la maîtrise (14 144$ de plus que le baccalauréat). Le doctorat, et le DEC technique sont les exceptions puisque ces formations n’offrent pas de différences avec le niveau de scolarité qui les précède. Il faut toutefois préciser que les données concernant le doctorat datent de 2001 plutôt que de 2003 et sont nettement moins fiables en raison du nombre peu élevé de répondants.
Notons toutefois que le facteur de l’expérience, qui ne devrait pas jouer sur les salaires puisque tous les diplômés sont relancés après une période identique, peut néanmoins intervenir si les étudiants universitaires ont des emplois étudiants durant leurs formations, ce qui est bien souvent le cas durant l’été et même durant l’année scolaire. Quant aux salaires élevés que les diplômés universitaires peuvent espérer, il faut aussi prendre en compte l’endettement accru résultant de cette scolarité plus longue.
Pour ce qui est du lien entre la formation et l’emploi occupé, il n’est pas étonnant de constater que les diplômés déclarent que ce lien existe davantage lorsque leur scolarité s’accroît. C’est du moins ce dont fait état la Relance des diplômés du ministère de l’Éducation, comme en témoigne le graphique 1.1.4 ci-dessous, tiré du tableau 1.1.8. On y constate que le lien entre la formation et l’emploi occupé est somme toute assez fort pour ces diplômés. Le DEC augmente de façon appréciable ce lien par rapport aux formations données au secondaire, tout comme le doctorat, bien que les données sur celui-ci datent de 2001. Au contraire, le lien formation-emploi constaté par les diplômés du baccalauréat est décevant comparé aux autres niveaux de scolarité. Rappelons qu’il est fort probable que le temps investi dans une formation engendre un désir de trouver un emploi où cette formation sera utile.
Une étude longitudinale réalisée entre 1993 et 1999 auprès d’une cohorte de diplômés du secondaire, du collège et de l’université permet d’apporter quelques nuances à ce constat. Cette étude de Geneviève Fournier, Kamel Béji et Line Croteau [20] montre une plus faible fréquence du lien entre la formation et l’emploi que l’enquête du MEQ et présente aussi l’évolution de ce lien au cours des cinq années suivant la diplomation, tel qu’illustré par le graphique 1.1.5.
Ainsi, on constate qu’après 6 mois et 18 mois, les diplômés du collégial sont avantagés par rapport aux autres diplômés. Entre ces deux moments, les auteurs soulignent que la diminution générale du lien formation-emploi s’explique par le fait qu’un plus grand nombre de diplômés se soit trouvé un emploi, reflétant du même coup « une certaine « acceptation » par les jeunes diplômés de la réalité du marché du travail qui ne leur garantit pas forcément un emploi correspondant à leurs compétences ni à leur formation [21] ». Après trois et cinq ans, les diplômés universitaires semblent mieux s’adapter au marché du travail et voient la proportion d’entre eux occupant un emploi lié à leur formation augmenter. Les diplômés collégiaux vivent une adaptation un peu plus ardue, vu la baisse subie après trois ans, mais leur situation s’améliore nettement après cinq ans, à tel point qu’elle est pratiquement équivalente à celle des universitaires à ce moment, ce qui est cohérent avec les données de la Relance des diplômés qui montrait les diplômés collégiaux en avance sur les bacheliers. Pour ce qui est de la situation des diplômés du secondaire, elle montre une « évolution en dents de scie [qui] est souvent justifiée par des parcours professionnels chaotiques pour les individus peu scolarisés » [22], selon les auteurs.
La satisfaction envers le travail selon la scolarité est traitée sommairement dans un article de Vultur, Trottier et Gauthier [23]qui cite les travaux de Paugam [24] sur la situation en France, mais dont les constats, très généraux, ne doivent pas être si éloignés de la situation québécoise. Pour ce qui est de la satisfaction liée à l’épanouissement que permet le travail, « les ouvriers non qualifiés sont moins satisfaits des qualités intrinsèques qu’ils attribuent à leur travail que les cadres » [25]. En termes de satisfaction face à la rétribution, Paugam note que « les jeunes de moins de 25 ans se disent plus souvent satisfaits de leur salaire que leurs aînés, alors que le salaire qu’ils reçoivent est en moyenne nettement plus bas » [26]. Ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que « les jeunes ont des attentes moins élevées, l’essentiel étant pour eux de faire leurs preuves et de se faire reconnaître par leur employeur afin de conserver le poste qu’ils occupent » [27]. Ce constat très pertinent constitue une piste de réflexion importante. Enfin, les ouvriers non qualifiés sont « les plus insatisfaits des relations entre collègues » [28]. L’âge est donc un facteur principalement lorsque l’on considère la satisfaction à l’égard de la rétribution alors que les catégories professionnelles, déterminées notamment par la scolarité, influencent l’épanouissement et la qualité des relations humaines qu’offre le travail.
Enfin, la capacité de faire des projets à long terme est étroitement liée au sentiment de précarité, mais pas seulement à ce facteur. Les deux graphiques 1.1.6 et 1.1.7 ci-dessous sont tirés encore une fois de l’article de Fournier et al. sur l’insertion socioprofessionnelle des diplômés et illustrent ces deux éléments.
Ainsi, le sentiment de précarité diminue-t-il avec le temps pour tous les diplômés, mais plus rapidement pour les diplômés universitaires. Selon les auteurs, « ce résultat confirme indirectement l’amélioration globale de la situation professionnelle » [29]. Il demeure toutefois troublant de constater que les diplômés postsecondaires ressentent toujours dans une plus grande proportion la précarité que les diplômés du secondaire après cinq ans. Ce résultat est toutefois aussi présent lorsqu’on considère la capacité de faire des projets à long terme. Peu importe la période considérée, ce sont toujours les diplômés du secondaire qui s’en sentent capables dans la plus grande proportion. Tant après six mois qu’après cinq ans, les diplômés universitaires démontrent moins de confiance que ceux du collégial. Les auteurs font aussi remarquer que, « en dépit d’une augmentation trois ans après la diplomation, la capacité de faire des projets demeure assez stable entre la première et la dernière étape de l’étude » [30]. Ce résultat est donc différent de la baisse observée du sentiment de précarité.
Pour tenter d’expliquer l’évaluation des diplômés de leurs capacités de faire des projets à long terme, et particulièrement la faible évaluation qu’en font les diplômés universitaires, il est possible de se pencher sur le niveau d’endettement des diplômés, un endettement généralement plus lourd lorsque les études sont plus longues. Les niveaux d’endettement observés par les auteurs sur les sujets de leur étude montrent bien le poids important de l’endettement des universitaires après leurs études, mais ils montrent aussi que ce poids est toujours très important cinq ans après la diplomation [31] . Il est donc bien possible que l’impact de ces dettes inhibe la capacité de faire des projets à long terme, même lorsque la situation des diplômés sur le marché du travail semble assez stable. Selon Fournier et al., le niveau élevé d’endettement des diplômés engendre chez certains « l’impression que les études hypothèquent davantage l’avenir qu’elles ne l’assurent » [32].
Ce constat est aussi partagé par Marie-Claude Gagnon, qui rapporte que « cet endettement crée des sentiments de détresse, et nous constatons que plus la situation financière est difficile, plus les étudiants et étudiantes sont pressés de trouver un emploi. Cela peut avoir pour effet qu’ils ne trouveront pas forcément un emploi lié à leur formation, et que le curriculum vitae gardera trace de plus d’emplois à temps partiel » [33].
Les conséquences de l’endettement pourraient probablement êtres moindres si l’endettement lui-même n’était aussi élevé. Toutefois, Marie-France Maranda et Chantal Leclerc, ayant réalisé une étude auprès d’étudiants en sociologie, nous éclairent quant à la perception de certains étudiants sur leurs propres dettes : « L’argent est un sujet que l’on n’aime pas évoquer. Cela rappelle trop crûment comment les situations personnelles sont vulnérables à cet égard. Pour ne pas que ces problèmes gâchent les études, il faut tenter d’écarter de son esprit les préoccupations financières. La banalisation de la dette est une stratégie qui permet de relativiser une situation aberrante. Se projeter dans trois ou cinq ans avec une dette de 20 000 $ ou 25 000 $ est impensable lorsque l’on peine à assumer le quotidien. Voir s’additionner les montants à un rythme quasi exponentiel perd de son effet lorsque les chiffres prennent des allures astronomiques à l’échelle des individus. Alors, on continue… » [34] . Ainsi, la réalité de l’endettement n’apparaît pas toujours clairement aux étudiants engagés dans le projet de leurs études. Ils savent néanmoins que leur situation entraînera des sacrifices : « on renonce par anticipation aux voyages, à l’automobile, aux dépenses entraînées par la fondation d’une famille, du moins au désir d’avoir des enfants tôt » [35] , ce qui nous conduit à faire ici un lien avec le taux de fécondité.
Une des conséquences du sentiment de précarité des diplômés, et de leur incapacité à faire des projets à long terme, peut prendre la forme du report du projet familial. Dans un contexte de déclin démographique, cette conséquence semble des plus pertinentes à étudier. Dans la revue de littérature intitulée Jeunes et fécondité : les facteurs en cause, Madeleine Gauthier et Johanne Charbonneau soulignent en effet que depuis les années 1950, « la pression sociale à propos de l’éducation des enfants s’est accentuée » [36]et que dès lors, « il n’est pas étonnant que l’enfant soit alors envisagé comme un « coût économique », dont on accepte la responsabilité seulement lorsqu’on a assuré sa stabilité professionnelle et financière, toujours plus compromise par le processus prolongé et précaire d’insertion professionnelle des jeunes qu’on connaît aujourd’hui » [37] . Ce constat suggéré aux auteurs se trouve décliné sous différents angles par plusieurs études, notamment lorsqu’on constate que « les jeunes Québécoises dans la vingtaine ont un discours normatif sur la maternité » [38] et qu’ « elles évoquent, en effet, l’importance de pouvoir donner à son enfant le meilleur, ce qui implique de bien se préparer au point de vue professionnel, conjugal et personnel » [39] . Un sondage réalisé par le Conseil de la famille et de l’enfance en 1998 auprès de jeunes ayant entre 20 et 35 ans atteste d’ailleurs que « 76 % des sondés sont d’avis que c’est à cause de la situation économique des familles si on fait peu d’enfants au Québec » [40] , ce qui vient étayer une fois de plus le lien entre la situation économique et la fécondité. Bien qu’il ne s’agisse pas des seuls facteurs en cause, il n’est donc pas farfelu de penser que la précarité ressentie par les jeunes, et leur incapacité de faire des projets à long terme, peuvent nuire à leurs projets en termes de famille.
Bien entendu, la fondation d’une famille est un projet possible parmi bien d’autres, et de nombreux facteurs peuvent participer à la baisse du niveau de fécondité au Québec. D’autres projets à long terme des diplômés et des jeunes en général peuvent potentiellement se trouver compromis par le sentiment de précarité que ressentent certains d’entre eux, l’accès à la propriété par exemple. Ce qui ressort néanmoins des réflexions de ces auteurs, c’est que les études comportent pour plusieurs un coût appréciable qui en diminue les avantages, du moins du point de vue matériel. Il semble que le choix de pousser plus avant sa scolarité ne soit plus un gage indubitable d’enrichissement, et ce malgré tous les effets positifs d’une scolarisation plus poussée sur la capacité de se trouver un emploi, sur les salaires, sur le lien entre l’emploi et la formation ou sur la satisfaction au travail.
1.2 Le travail étudiant
En lien avec l’augmentation des années consacrées à la scolarité, et malgré la présence du programme d’aide financière aux études, de plus en plus d’étudiants travaillent durant leurs études, en moyenne de 15 à 20 heures par semaine [41] . Les motivations de ce travail des étudiants sont souvent de nature financière. Néanmoins, elles peuvent être « de développer des compétences, d’acquérir de l’expérience et des responsabilités, et [le travail étudiant] procure souvent un réseau social et un réseau d’appartenance » [42] . Le travail chez les étudiants est considéré comme habituel durant les périodes estivales ou lorsqu’il s’agit d’étudiants à temps partiel. Il est toutefois possible de considérer le phénomène du travail étudiant hors de ces paramètres usuels. Les données disponibles sur le travail des étudiants à temps plein durant l’année scolaire, de septembre à avril, démontrent un accroissement de ce phénomène. Les tableaux 1.2.1 et 1.2.2 qui suivent, résument bien la situation.
Cette évolution chez les 15 à 29 ans n’est pas uniforme selon la tranche d’âge. La proportion d’étudiants à temps plein qui travaillent est particulièrement élevée chez les 20 à 24 ans, soit 51,6 % en 2003. Il s’agit du double de la proportion observée en 1976, alors que 25,5 % des étudiants de cet âge travaillaient. La proportion des 15 à19 ans aussi a plus que doublé durant cette période, passant de 14,7 % à 33,9 %, alors que les 25 à 29 ans sont passés de 31,0 % à 45,1 %. Ainsi, les étudiants les plus âgés ne sont plus ceux qui travaillent dans la plus grande proportion en 2003, contrairement à la situation qui prévalait en 1976. Il faut toutefois noter que les étudiants à temps plein âgés de 25 à 29 ans n’étaient que 17 100 en 1976, dont 5 300 occupaient un emploi. En 2003, ils sont pratiquement quatre fois plus nombreux en emploi, soit 20 300, notamment parce que les effectifs étudiants de cette tranche d’âge a pratiquement triplé, passant de 17 100 en 1976 à 45 000 en 2003.
Le tableau suivant résume la croissance des emplois d’étudiants durant l’année scolaire comparativement à l’évolution des effectifs, par tranche d’âge :
On constate que ce sont les 20 à 24 ans qui ont manifestement contribué le plus à l’évolution du travail étudiant. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un phénomène généralisé pour toutes les tranches d’âge. S’il est impressionnant de constater qu’un étudiant à temps plein sur deux travaille parmi les 20-24 ans, il est au moins aussi surprenant de voir qu’un sur trois le fait parmi les 15-19 ans, soit des étudiants plus jeunes qui terminent leurs études secondaires ou qui poursuivent des études collégiales. Le graphique 1.2.1 illustre l’évolution du travail étudiant par tranche d’âge.
Le graphique précédent illustre la tendance du travail étudiant depuis 1976. Notons toutefois que les résultats pour 2004 ne sont que partiels et ne prennent en compte que les mois de janvier à avril 2004, les données pour la session d’automne n’étant pas encore disponibles. On y voit notamment qu’après une stabilisation du travail étudiant dans les années 90, la tendance est repartie à la hausse depuis 1998.
Par ailleurs, cette tendance à la hausse du travail étudiant s’est surtout traduite par des emplois à temps partiel. Pourtant, quelque 17 500 étudiants parmi ceux qui travaillent le font aussi à temps plein, soit généralement plus de 30 heures par semaine. Cet extrême représente une faible part du phénomène d’ensemble ; il demeure néanmoins inquiétant sachant que des milliers d’étudiants à temps plein doivent conjuguer leurs études avec un emploi à temps plein.
1.3 L’insertion professionnelle et le chômage des jeunes
Le marché du travail québécois ne s’est pas aussi bien porté qu’actuellement depuis très longtemps. La croissance économique soutenue depuis des années bénéficie à l’emploi. En avril 2005, le taux de chômage était de 7,9 %, un taux record depuis des décennies. L’écart avec l’Ontario et le reste du Canada, d’à peine plus d’un point, montre le rattrapage important du Québec. Même la situation des jeunes s’est largement améliorée ses dernières années. Cet état de fait complique cependant l’analyse de la situation des jeunes sur le marché du travail puisque les données reflètent en grande partie la conjoncture favorable. La conjoncture influençant particulièrement les jeunes, il devient très difficile de distinguer les facteurs profonds de la situation des jeunes en emploi.
Ainsi, il faut retenir que malgré l’économie florissante, la progression de l’emploi et de l’emploi à temps plein ces dernières années, la convergence des situations des hommes et des femmes [43] , ou le rattrapage relatif du Québec sur la moyenne canadienne, la tendance de fond est que les jeunes sont davantage touchés par le chômage que les travailleurs plus âgés.
Nous tenterons donc de discerner dans les chiffres relatifs au chômage les difficultés actuelles des jeunes. Pourquoi le taux de chômage est-il un indice si adapté ? Parce qu’il peut être considéré comme la mesure de l’exclusion, « l’inefficacité du marché du travail » face à un groupe, ici les jeunes. Le chômage regroupe les individus faisant partie de la population active qui se cherchent un emploi sans s’en trouver. Rappelons que les individus qui poursuivent des études sans chercher de travail sont considérés comme faisant partie de la population inactive.
Le taux de chômage selon l’âge
Le chômage des jeunes a généralement été plus élevé que le chômage global. Cependant, le phénomène a pris de l’ampleur dès la fin des années 60. Contrairement à la croyance populaire, qui veut que tout était facile en 1970, Monique Frappier fait état de l’augmentation marquée du taux de chômage, une détérioration résultant selon ses résultats de l’entrée massive des baby-boomers sur un marché du travail éprouvant des difficultés à les absorber. Par exemple, entre 1966 et 1971, le taux de chômage double chez les 15-19 ans (de 9,5 % à 19,1 %) et chez les 20-24 ans (de 5,0 % à 10,5 %). Pendant ce temps, la hausse du chômage est moindre pour les 25-34 ans (de 3,6 % à 6,6 %) et surtout pour les 35-64 ans (de 4,0 % à 6,1 %) [44] .
Dans ses travaux, Monique Frappier démontre que cette hausse des taux de chômage simultanée à l’entrée des baby-boomers s’est prolongée durant les décennies 70 et 80, suivant les baby-boomers malgré leur évolution à travers les groupes d’âge, tout en perdant de son intensité : « l’accroissement des taux de chômage des larges cohortes n’est pas un phénomène permanent. Il semble bien qu’à ce sujet, les baby-boomers finissent par rattraper le taux de chômage des adultes (sic) à la longue » [45] . Ainsi, les taux de chômage élevés des jeunes ne sont pas un phénomène récent.
Néanmoins la longévité du phénomène n’atténue pas la situation du jeune qui ne se trouve pas d’emploi. Les graphiques 1.3.1 et 1.3.2 représentent l’évolution des taux de chômage au Québec entre 1976 et 2004 pour différents groupes d’âge. Les premiers constats à en tirer concernent la situation particulièrement difficile des jeunes de 15 à 24 ans, soit la tranche d’âge dont le taux de chômage est toujours le plus élevé :
• Le taux de chômage des 15-24 ans, dont la moyenne est de 16,7 %, est très rarement descendu sous les 14 % durant cette période.
• Leur taux de chômage est systématiquement plus élevé que celui de la population (composée des 15 ans et plus), l’écart entre les deux groupes étant en moyenne de 5,8 points de pourcentage en défaveur des plus jeunes. Tous les autres groupes d’âge montrent un écart moyen négatif par rapport aux 15 ans et plus pour la période.
• Cet écart moyen des 15 à 24 ans a tout de même diminué, mais il demeure encore de 5,2 points de pourcentage en défaveur des jeunes pour les années 2000 à 2004 (Tableau 1.3.1).
• Cette tranche d’âge est particulièrement sensible à la conjoncture économique. Non seulement leur taux de chômage est contracyclique [46] , comme l’est généralement le taux de chômage, mais leur écart par rapport au chômage général l’est aussi. Cette situation est bien visible dans le graphique 1.3.2 où les récessions du début des années 80 et 90 ont entraîné une hausse de l’écart des 15-24 ans. Cela signifie que le taux de chômage des 15-24 ans a alors augmenté plus rapidement que le taux de chômage de la population en général.
• Un constat positif s’impose aussi. Lors des reprises consécutives à ces deux récessions, c’est le taux de chômage des jeunes qui a diminué le plus rapidement comme le graphique 1.3.1 le démontre, entraînant par le fait même une baisse de leur écart avec le chômage des 15 ans et plus (graphique 1.3.2).
Ces constats peuvent en partie trouver leurs racines dans le fait que les travailleurs les plus jeunes sont moins scolarisés et moins expérimentés que la moyenne des travailleurs. Ils sont aussi souvent les derniers arrivés en emploi. Ainsi, ils se situent souvent complètement au bas des échelles organisationnelles, ce qui rend leur situation plus précaire que celle de leurs aînés et engendre un chômage plus fréquent. En quelque sorte, les jeunes forment un bassin de travailleurs très flexibles et bon marché avec lequel les entreprises peuvent répondre à la conjoncture par des embauches ou des licenciements.
Les 25-34 ans s’en sortent bien mieux que les 15-24 ans avec des taux de chômage autour de 10,6 % entre 1976 et 2004, une moyenne qui est même inférieure à celle de la population dans son ensemble (10,8 % pour les 15 ans et plus). Ces dernières années, le graphique 1.3.2 nous montre que le taux de chômage des 25-34 ans était inférieur au taux de chômage général. En effet, l’écart négatif observé depuis 1997 signifie que pour la première fois depuis 1982, leur situation est meilleure que la moyenne. Cependant, le taux de chômage des 25-34 ans est plus élevé que celui des 35-44 ans en règle générale. Les années 2001 et 2002 furent les exceptions à cette règle, lorsque la situation s’est inversée à l’avantage des 25-34 ans.
Ce qui apparaît comme un fait surprenant à prime abord semble cependant relever d’une convergence des taux de chômage de ces deux groupes d’âge amorcée en 1994. Le graphique 1.3.2 montre en effet que les écarts des 25-34 ans et des 35-44 ans sont de plus en plus similaires depuis cette année-là. Ce phénomène de convergence s’observe aussi entre 1985 et 1989, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les 25-34 ans sont aussi sensibles à la conjoncture, bien qu’avec moins d’ampleur que les 15-24 ans. Cette sensibilité n’apparaît en effet que par comparaison avec les 35-44 ans, parce que la moyenne générale des 15 ans et plus est influencée par les 15-24 ans.
La durée du chômage
L’évolution comparée des trois tranches d’âge montre bien que les années d’expérience sur le marché du travail jouent pour beaucoup sur la prévalence du chômage. Ainsi, l’âge est un facteur qui influence à la fois le niveau moyen du chômage et les variations qui surviennent selon la conjoncture économique. Il influence aussi la durée du chômage, puisque « si les jeunes risquent davantage de se retrouver au chômage, ils en ressortent par contre plus rapidement que leurs aînés. Le chômage de longue durée (un an ou plus) ne touchait, en 1996, que 6 % des jeunes demandeurs d’emploi, contre 20 % des chômeurs de 25 ans et plus, pourcentage qui monte à 25 % chez les plus de 45 ans » [47] . Cette situation peut s’expliquer par différentes causes : « à défaut d’une grande expérience, ils [les jeunes] ne subissent pas le handicap de l’âge auquel font face les personnes qui ont passé le milieu de la quarantaine, à cause des préjugés entretenus envers les travailleurs plus âgés. D’autre part, plusieurs jeunes, devant l’impossibilité de se trouver un emploi qui leur convienne, décident de retourner aux études, ce que tend à confirmer l’accélération de l’augmentation de la fréquentation scolaire en période de mauvaise conjoncture. Enfin, puisqu’ils sont plus souvent exposés que leurs aînés à perdre leur emploi, ils sont souvent plus familiers avec les techniques de recherche d’emploi » [48] . Ces réflexions sont encore vérifiées par les données récentes [49] .
Le constat de l’ampleur du chômage chez les jeunes doit cependant être nuancé par un élément qualitatif d’importance, soit que le chômage représente généralement une épreuve moins pénible pour les jeunes que pour les plus âgés. Ne pas avoir de travail correspond à une situation d’autant plus pénible qu’elle implique des sacrifices pour soi et ses proches. Le fait d’avoir des enfants à charge, une hypothèque à payer, et d’autres contraintes pour lesquelles on dépend d’un revenu stable aggravent la situation d’un travailleur qui se retrouve sans emploi. Ces mêmes éléments peuvent aussi représenter des contraintes à la mobilité qui limitent la recherche d’emploi à la région immédiate. Or, les jeunes travailleurs n’ont pas tous à faire face à ces responsabilités, surtout les 15-19 ans. Les 25-34 ans par contre sont plus susceptibles d’être dans cette situation inconfortable. L’impact qualitatif du chômage est donc moindre sur les plus jeunes que sur les travailleurs plus âgés.
Un autre constat, quantitatif celui-là, vient mettre en perspective le chômage des jeunes. Il s’agit de la durée du chômage, nettement plus courte pour les groupes d’âge de 15 à 34 ans. Le graphique 1.3.3 suivant illustre l’évolution de la durée moyenne du chômage au Québec entre 1997 et 2004.
On y constate d’une part que la période moyenne de chômage est plus courte chez les plus jeunes. Outre en 1998, où les 35-44 ans avaient une durée moyenne de chômage plus élevée que celle des 45-54 ans, la durée moyenne de chômage s’élève avec l’âge pour les sept autres années considérées. Deux explications pourraient facilement rendre compte de ce constat : soit que les jeunes peuvent retourner aux études plus facilement que les travailleurs plus âgés lorsqu’ils font face à une période prolongée de chômage, soit qu’ils forment une main d’œuvre plus flexible démontrant une meilleure résilience face aux aléas du marché du travail, ce qui recoupe les hypothèses d’André Grenier citées précédemment.
D’autre part, la période moyenne de chômage s’amenuise entre 1997 et 2004 pour tous les groupes d’âge, un résultat qui n’est certes pas surprenant puisque le taux de chômage aussi a constamment diminué durant ces années, passant de 11,6 % en 1997 à 8,5 % en 2004. La durée du chômage, comme le chômage en lui-même, est un phénomène contracyclique, et sa diminution démontre la vitalité économique des dernières années. Toutefois, bien que la situation des jeunes d’ici soit meilleure que celle de leurs aînés à ce chapitre, rappelons qu’elle est tout de même moins bonne que celle des jeunes canadiens. Encore en 2003, la durée moyenne du chômage des jeunes québécois de 15 à 24 ans était de 10,2 semaines contre une moyenne canadienne de 9,8 semaines.
L’impact du chômage chez les jeunes n’est donc pas dramatique en termes de durée. Néanmoins, ne pas se trouver de travail alors qu’on en cherche un n’est jamais une situation souhaitable. Ainsi, bien qu’il soit bon de le mettre en perspective, le chômage des jeunes représente malgré tout un problème préoccupant.
Les jeunes en emploi dans le secteur des services
Sous l’effet combiné de la diminution de leur poids démographique et de l’allongement de leur scolarité, les jeunes de 15 à 24 ans représentent une part de plus en plus réduite de la population active, et parmi ceux-ci, plusieurs travaillent à temps partiel. Ceux qui se retrouvent sur le marché du travail font aussi l’objet de mouvements entre secteurs d’activité. En effet, comparé au portrait de 1976, la place des jeunes dans les différents secteurs d’emploi a notablement évoluée. Les données tirées de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada qui sont illustrées au tableau 1.3.2 sont éloquentes à ce propos.
Ce tableau nous permet de constater que le nombre de jeunes en emploi a diminué de façon importante au cours des quelques trente dernières années, passant de 664 200 à 552 900. Surtout, on peut y voir le déplacement de l’emploi vers le secteur des services, regroupant 4 jeunes en emploi sur 5 contre 2 sur 3 en 1976, alors que le pourcentage de jeunes travaillant dans les secteurs de la production de biens a décru, passant de 32,7 % à 18,4 %.
Le tableau 1.3.3, quant à lui, permet de mesurer le même déplacement vers le secteur des services en illustrant le fait qu’il s’agit d’un secteur où les jeunes occupent une proportion d’emplois plus importante que leur poids dans l’ensemble des industries. C’était déjà le cas en 1976. Ce qui a changé, c’est l’écart important qui existe maintenant entre la sur-représentation des jeunes dans le secteur des services et leur sous-représentation dans le secteur de la production de biens. Le cas du secteur de la fabrication, où les jeunes occupaient la même proportion d’emplois que dans celui des services en 1976, est le meilleur exemple de la transformation qui a eu lieu. Un autre indice intéressant est révélé par le fait que malgré la diminution de leur nombre total en emploi, les jeunes en emploi dans les services ont tout de même augmenté de 3 900 entre 1976 et 2003.
Le phénomène de la tertiarisation de l’économie, ayant transformé le visage industriel du Québec, s’est appliqué davantage aux jeunes travailleurs. Le mouvement illustré par les deux tableaux précédents est aussi présent dans les autres tranches d’âge. Que l’ampleur de ce phénomène soit plus importante chez les plus jeunes n’a rien d’étonnant et illustre simplement la flexibilité des jeunes à l’environnement économique. Cette flexibilité présente toutefois un revers. Si elle permet aux jeunes travailleurs de s’orienter vers les secteurs qui sont en plein essor, elle les pousse parfois à accepter des conditions de travail inférieures à celles auxquelles ils auraient pu s’attendre.
Le secteur des services regroupe un grand nombre d’industries. En analysant plus finement où les jeunes se sont dirigés lorsqu’ils se sont déplacés vers ce vaste secteur, on comprend mieux les impacts sur leurs conditions de travail. C’est ce qu’illustre le tableau suivant :
À l’image de leur répartition entre le secteur de la production de biens et le secteur des services, on constate que les jeunes ne sont plus aussi également répartis entre les différentes industries : autrement dit, les écarts se sont accentués. Les industries où les jeunes sont le moins représentés sont les mêmes qu’en 1976, soit le transport et l’entreposage (7,4 %), les administrations publiques et les services d’enseignement, un autre système public (7,5 % chacun). Mis ensemble, les jeunes qui travaillent dans ces industries représentent 10 % des jeunes qui travaillent dans les services, alors qu’en 1976, cette proportion était tout de même de 19 % [50] . À l’opposé, le sommet du palmarès est constitué des industries de l’hébergement et de la restauration (40,3 %), du commerce (27,5 %) et de l’information, culture et loisirs (19,9 %). Ces trois domaines regroupent ensemble 63 % des jeunes travaillant dans les services, une proportion qui était de 44 % en 1976.
Les gains annuels moyens de chaque industrie, donnés dans la dernière colonne, montrent que celles dans lesquels les jeunes se retrouvent principalement sont parmi les moins rémunératrices. Les gains annuels moyens réalisés dans les emplois de l’hébergement et de la restauration sont clairement les plus bas, et de loin. Ce domaine était aussi celui où les jeunes occupaient la plus grande proportion des emplois, rappelons-le. Soulignons aussi qu’il s’agit de la seule industrie des services pour laquelle les gains annuels moyens n’ont pas évolué en douze ans. L’inverse est aussi vrai. Pour les domaines où les 15-24 ans sont peu présents, soit les administrations publiques et les services d’enseignement, les gains annuels moyens sont parmi les plus élevés.
La principale cause de cette répartition tient fort probablement dans la scolarité. Bien des jeunes de 15 à 24 ans sont encore aux études. Quant à l’évolution de la répartition entre 1973 et 2003, il est possible que l’élévation des exigences pour occuper les postes plus rémunérateurs ait contraint les jeunes à demeurer plus longtemps dans les postes qui le sont moins en attendant de terminer leur scolarité. Le portrait pour les jeunes de 25 à 34 ans est déjà plus encourageant, les industries des services professionnels et de l’information, de la culture et des loisirs se retrouvant en haut de liste, tel que présenté au tableau 1.3.5.
Par ailleurs, il est intéressant de constater la faible présence des jeunes dans la fonction publique. Le gouvernement, à travers son rôle d’employeur, porte la responsabilité de montrer l’exemple. Dans le cas des jeunes de moins de 35 ans, ils ne représentent seulement que 10,2 % de l’effectif régulier en 2003-2004 [51] . À la décharge du gouvernement, ce pourcentage a augmenté ces dernières années et les jeunes forment la presque totalité des étudiants et stagiaires, évidemment, qui ne sont pas comptés dans l’effectif régulier. Notons aussi que les communautés culturelles sont encore moins bien représentées, représentant 2,5 % de l’effectif régulier en 2003-2004 [52] .
La situation des jeunes des régions
L’état de l’insertion professionnelle des jeunes ne serait pas complet sans prendre en compte les variations régionales. En effet, le taux de chômage varie considérablement d’une région à l’autre et le graphique 1.3.4 présente les taux de chômage par région. Ainsi, en 2004, il y avait 13,7 points de pourcentage d’écart entre la région de la Capitale-Nationale (avec 5,8 %) et la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, dont le taux de chômage était trois fois plus élevé (à 19,5 %).
La perspective du chômage est aussi liée à celle des migrations interrégionales. En fait, le chômage peut même engendrer cette mobilité interrégionale, comme le souligne Madeleine Gauthier : « parmi les facteurs qui jouent beaucoup sur l’entrée ou la persistance sur le marché du travail, la difficulté de trouver de l’emploi dans la région d’origine tient un rôle important. Actuellement au Québec, certaines régions offrent peu d’ouverture et de telles conditions incitent à la mobilité, ce qui améliore le sort ni des individus, ni des régions » [53] . Le graphique 1.3.5 illustre les taux migratoires par région en 2003-2004. On y constate que les régions ayant un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise ont toutes un solde migratoire positif, à l’exception de Chaudière-Appalaches dont le solde migratoire était de -52 individus en 2004. Outre Montréal et la Mauricie, dont les taux migratoires en proportion de leurs populations sont faibles mais positifs, les régions ayant des taux de chômage plus élevés vivent souvent un exode.
Mais le chômage n’est pas qu’un facteur de la migration. Il peut aussi en être la résultante, comme l’explique Madeleine Gauthier dans son ouvrage sur la pauvreté chez les jeunes. En effet, « plus un individu est en rupture avec sa famille et son milieu environnant, plus il risque de connaître des formes […] de pauvreté » [54] . Ainsi, selon l’auteure, « les migrations ne sont pas sans lien avec le fait qu’il y ait autant de personnes qui vivent seules à se trouver sous le seuil de faible revenu. Les déplacements ont été si importants au Québec au cours des années 1980 que le Conseil des affaires sociales a attiré l’attention sur le fait que les régions étaient en train de se vider de leurs éléments dynamiques » [55] . Encore aujourd’hui, ces déplacements préoccupent nombre d’acteurs, surtout lorsqu’il est question de l’exode des jeunes qui peut compromettre la vitalité économique des régions qui en souffrent.
L’auteure souligne aussi que « la réussite dans l’insertion sur le marché du travail tient souvent à l’existence d’un réseau de relations qui ne joue pas seulement en tant que filière de recommandations auprès des employeurs (le « pushing » dont parlent les jeunes), mais en tant que moyen d’information sur les emplois disponibles » [56] . Or, les jeunes migrants ne bénéficient bien souvent que d’un faible, voire d’aucun réseau dans leur région d’arrivée. La migration peut ainsi engendrer une situation de chômage.
1.4 Conclusion
La situation économique des jeunes soulève de nombreux sujets d’inquiétudes envers leur insertion professionnelle. Le décrochage scolaire et la non-diplomation sont sans aucun doute les plus préoccupants, sachant les puissantes implications du niveau de scolarité sur l’emploi. Le travail étudiant, tout en n’étant pas un problème en soi, peut cependant laisser croire que l’allongement de la scolarisation entraîne cependant des conséquences sur l’endettement des étudiants, ce qui les porte à travailler parallèlement à leurs études avec de possibles impacts sur leur apprentissage et leur performance scolaire. À coup sûr, le travail étudiant n’offre ni une stabilité, ni une rémunération idéales. Idéalement, il pourrait fournir une expérience significative en lien avec le domaine d’étude, ce qui est toutefois loin d’être certain à l’heure actuelle. Enfin, la situation économique des jeunes est lourdement handicapée par leur taux de chômage élevé. Le prochain chapitre s’attardera aux conditions d’emploi des jeunes qui trouvent effectivement du travail.
Chapitre 2 : Les conditions d’emploi des jeunes
Ayant situé les jeunes par rapport au marché du travail et ayant donné un aperçu de quelques déterminants de l’insertion professionnelle des jeunes, nous abordons ici les conditions d’emploi actuelles des jeunes. Parmi plusieurs tendances observées, la croissance de l’emploi atypique et la situation salariale des jeunes retiennent particulièrement notre attention. En effet, le statut d’emploi et la rémunération constituent selon nous les principales conditions d’emplois auxquelles les travailleurs prêtent de l’importance. La durée de l’emploi, la participation aux régimes de retraite et la situation syndicale, qui font aussi partie des conditions d’emploi, sont aussi brièvement abordées. Les vacances payées et les divers régimes d’assurances ne sont pas abordés.
En étudiant ces conditions d’emploi, on constate que l’amélioration du marché du travail des dernières années n’entraîne pas automatiquement une amélioration des conditions d’emploi des jeunes. En fait, malgré certains signes positifs, la situation des jeunes en emploi semble bien se détériorer. Selon Madeleine Gauthier, « l’appauvrissement des jeunes peut être daté. Il surgit avec les difficultés économiques qui ont marqué la fin de la décennie 1970. Les jeunes ont été particulièrement vulnérables aux effets de la conjoncture : les derniers à entrer sur le marché du travail, ils sont souvent les premiers à en sortir. Ils ont été les premiers touchés par ce que les années 1980 allaient révéler comme étant bien plus qu’une conjoncture, mais un changement structurel du monde du travail » [57] . C’est pourquoi nous débuterons notre étude des conditions d’emploi par le travail atypique et la précarité.
2.1 Le travail atypique et la précarité
Le marché du travail subit de profondes transformations parmi lesquelles la croissance du travail atypique et précaire. Toujours selon Madeleine Gauthier, « la fragmentation actuelle avec, d’un côté, les emplois typiques et de l’autre, les emplois précaires, par ailleurs en augmentation, accentue les possibilités de fragilisation des conditions d’existence » [58] . En effet, les emplois à temps partiel, les emplois temporaires ou le travail autonome entraînent des conséquences tangibles pour ceux qui les occupent. Or, une recherche réalisée par le Conseil permanent de la jeunesse [59]atteste que les jeunes sont particulièrement touchés par cette transformation du marché du travail. Cette recherche intitulée Emploi atypique et précarité chez les jeunes : une main d’œuvre à bas prix, compétente et jetable !, pose plusieurs constats inquiétants sur l’évolution et les conséquences de la précarité. Cette étude servira à alimenter notre analyse pour les différentes catégories d’emplois atypiques.
D’un point de vue général, le travail atypique et la précarisation du marché du travail signifient que le type d’emploi permanent et à temps plein, dit « typique » ou « traditionnel », subit un recul et que de nouvelles formes d’emploi apparaissent. De l’avis de Diane-Gabrielle Tremblay, l’accroissement des horaires non-standards « …répond de plus en plus à une exigence des employeurs et non à une préférence des employés […] » par rapport à la conciliation travail-famille par exemple, bien qu’elle soit une raison évoquée pour expliquer l’emploi atypique [60] . Cela explique sans doute pourquoi le cumul d’emploi a plus que doublé dans la population de 15 ans et plus depuis 1976, avec les difficultés pour concilier les différents emplois qu’on imagine, afin de réduire la précarité. Le phénomène s’observe surtout chez les jeunes puisque 7 % des 15-24 ans sur le marché du travail avaient plus d’un emploi en 2003 [61].
Ainsi, si le chômage des jeunes est élevé, comme nous l’avons constaté au premier chapitre, la situation de ceux qui sont en emploi n’est pas nécessairement équivalente à celle des travailleurs plus âgés. Pour donner une idée de l’ampleur de ces phénomènes, le CPJ cite des données compilées par le ministère du travail : « au Québec, le nombre d’emplois atypiques a grimpé de 135 % entre 1976 et 1995 alors que l’emploi typique ne croissait que de 6,6 % » [62] . Et le CPJ rappelle que certains groupes sociaux sont plus affectés par cette progression, notamment les femmes, les personnes immigrantes et les jeunes.
Le tableau 2.1.1 qui suit est tiré de l’étude du CPJ. Il donne un portrait général des différentes catégories d’emplois atypiques.
L’étude du CPJ souligne qu’en 1999 « une proportion de 46,5 % de jeunes occupe un emploi atypique contre 33,1 % des travailleurs de 30 ans et plus. Chez les femmes de 15 à 29 ans, la proportion grimpe à 53 % ! De telles statistiques impliquent qu’on ne peut plus aborder la question de l’emploi des jeunes sans s’intéresser à l’emploi atypique » [63] . Par ailleurs, seule la catégorie du travail autonome compte une plus grande proportion chez les 30 ans et plus que chez les jeunes.
L’emploi à temps partiel
L’emploi à temps partiel est défini par Statistique Canada comme comptant moins de 30 heures par semaine. Il est donc moins rémunérateur que l’emploi à temps plein pour un même salaire horaire, et pourtant certains travailleurs souhaitent ce type de travail pour différentes raisons. Toutefois, il arrive fréquemment que le travail à temps partiel soit un état involontaire.
De 1976 à 2003, dans la population de 15 ans et plus, la proportion de travailleurs à temps partiel a doublé, passant de 9,0 % à 18,4 %. Cet accroissement de l’emploi à temps partiel est détaillé par groupe d’âge dans le tableau 2.1.2. On y constate notamment que les jeunes ont été plus affectés que les autres tranches d’âge par cette transformation du marché du travail. En 2003, 45 % des 15-24 ans travaillent à temps partiel, une proportion trois fois plus importante qu’en 1976 et une progression de plus de 30 points de pourcentage. Chez les 25-54 ans, l’emploi à temps partiel n’a pas tout à fait doublé durant cette période. Plus encore, l’écart entre les parts de l’emploi à temps partiel s’est généralement accru entre les 15-24 ans et la population de 15 ans et plus, passant de 5,7 % en 1976 à 15,7 % en 1986, puis à près de 27 % en 1993.
Cette augmentation s’est surtout produite au cours des années 80, comme l’illustre le graphique 2.1.1. Le phénomène s’est stabilisé durant les années 90, oscillant entre 17 % et 18 % pour la population de 15 ans et plus. Les 15-24 ans ont connu une véritable explosion du travail à temps partiel durant la décennie 80. Comme pour la population en général, ce phénomène s’est néanmoins stabilisé par la suite. Le graphique illustre aussi l’évolution de l’emploi à temps partiel chez les 55-64 ans qui présentent une augmentation plus importante que les 25-54 ans. Dans le tableau 2.1.2, on voit aussi que le travail à temps partiel est répandu chez les travailleurs de 65 ans et plus, à tel point que l’emploi à temps partiel est pratiquement aussi courant que chez les 15-24 ans. Bref, à la sortie du marché du travail, il semble qu’on ait tendance à diminuer le temps travaillé. Toutefois, chez les travailleurs les plus âgés, l’impact du travail à temps partiel n’est sans doute pas le même.
Cette analyse rejoint celle d’André Grenier, d’Emploi-Québec, qui constate que « la part de travail à temps partiel s’est accrue avec les années pour tous les groupes d’âge. (…) Le phénomène a cependant été nettement plus marqué du côté des jeunes [15-24 ans], chez qui la part des emplois à temps partiel est passée de 14,6 % à 44,4 % [entre 1976 et 1996] » [64] .
L’étude du Conseil permanent de la jeunesse présente des données pour les 15-29 ans par tranche de 5 ans. Le tableau 2.1.3 est une reproduction du tableau 3 de la recherche du CPJ [65] . Ce tableau montre que si le travail à temps partiel est principalement le fait des 15-19 ans, l’évolution est aussi impressionnante chez les 20-24 ans : « la proportion de travailleurs à temps partiel dans ce groupe d’âge a pratiquement quadruplé au cours de cette période, passant de 7,6 % à 30,3 % » [66] . Quant au 25-29 ans, leur situation est presque semblable à celle des 30 ans et plus, bien que l’écart était tout de même de près de 2 % en 1999.
Les jeunes qui travaillent à temps partiel le font souvent par choix : « la raison la plus souvent invoquée par les 15-24 ans pour le travail à temps partiel est d’ailleurs la fréquentation scolaire. Elle était citée dans 58 % des cas en 1976 et dans 61 % des cas en 1995 » [67] . En effet, les données de Statistique Canada présentée dans le tableau 2.1.2 et le graphique 2.1.1 ci-haut ne prennent pas en compte le statut d’étudiant. Une partie de l’évolution du travail à temps partiel peut donc s’expliquer par la croissance du travail étudiant tel que constaté dans le chapitre précédent. Cependant, « on ne peut expliquer tout le travail à temps partiel par la scolarisation accrue des jeunes et le nombre grandissant d’étudiants qui travaillent » [68] . De même, les motivations des travailleurs à temps partiel doivent être replacées dans leur contexte.
On peut observer les motivations du travail atypique par certaines données de Statistique Canada, qui ne sont toutefois disponibles que depuis 1997. Si elles ne permettent pas une compréhension suffisante de l’évolution des motivations, ces données démontrent tout de même que bon nombre de jeunes de 15 à 24 ans se retrouvent dans cette situation pour des raisons dites volontaires. Que ce soit en raison de la poursuite des études ou par choix personnel, les différences avec la population en emploi de 25 ans et plus sont frappantes.
Dans le cas des plus jeunes, c’est environ trois travailleurs à temps partiel sur quatre qui choisissent ce type de travail en raison de la fréquentation scolaire. Une proportion si importante explique une bonne part des quelques 30 % de 15 ans et plus dans le même cas. Ainsi, en ne considérant que les 25 ans et plus, comme dans le graphique 2.1.2 précédent, l’on constate que ce ne sont que 5 % qui travaillent à temps partiel en raison de l’école. Par ailleurs, pour ce qui est des plus jeunes, leur taux semble s’être stabilisé de 2001 à 2003 autour de 76 %. Cette stabilisation demeure cependant très récente, trop récente pour en tirer des conclusions pour l’avenir.
L’autre raison fréquemment invoquée lorsque le travail à temps partiel est « volontaire » est le choix personnel. Dans ce cas, les 25 ans et plus invoquent cette raison dans près de 40 % des cas, alors que ce n’est le fait que de 4,1 % des jeunes de 15 à 24 ans.
Malgré tout, certains se contentent du travail à temps partiel faute de mieux. C’était le cas de 184 300 personnes en 2003, dont 44 500 jeunes de 15 à 24 ans. Le graphique 2.1.4 en montre l’évolution. L’écart entre les 15-24 ans et les 25 ans et plus reflète bien l’analyse vue plus haut, soit qu’une forte proportion de jeunes travaillant à temps partiel choisit cette situation. On y constate aussi une baisse générale du temps partiel involontaire, mais rappelons que la période couverte par les données en fut une de croissance économique et d’un marché du travail vigoureux. Il n’est dès lors pas si étonnant que si peu de travailleurs occupent un travail à temps partiel de façon involontaire, ni de voir son importance reculer depuis 1997. La diminution des situations « involontaires », plus accentuée chez les jeunes, confirme une fois encore qu’ils bénéficient plus que les travailleurs plus âgés des conjonctures économiques favorables. Pour être plus significatives, les données auraient dû couvrir au moins un cycle économique entier, ce qui n’est pas le cas ici et nous oblige à nous rabattre sur d’autres données.
Ainsi, certains affirment travailler à temps partiel parce qu’ils sont incapables de se trouver un emploi qui soit à temps plein, comme le rappelle André Grenier : « En 1976, 17 % des jeunes travailleurs [15-24 ans] à temps partiel l’invoquaient [cette incapacité], contre 28 % en 1995 » [69] . Depuis 1995, l’embellie du marché du travail au cours des dernières années aurait donc permis de ramener ce pourcentage au niveau de 1976.
Voilà à notre avis un constat marquant. Que l’évolution du travail à temps partiel ait reflété l’évolution des travailleurs désirant travailler à temps partiel n’aurait pas été problématique. Comme le constate André Grenier, on sait que ce n’est pas le cas et que nombreux sont les travailleurs qui cherchent des opportunités plus intéressantes sans toutefois pouvoir les trouver. Il semble possible de postuler que l’insertion professionnelle de ces travailleurs en souffrent durablement, car non seulement y a-t-il pertes salariales à cause du peu d’heures travaillées, mais l’expérience pertinente sur le marché du travail s’accumule moins rapidement pour la même raison. Dans ce cas de figure, le travail à temps partiel involontaire influence les gains salariaux pour plusieurs années, même lorsqu’un travail à temps plein est enfin déniché comme ce fut probablement le cas pour de nombreux jeunes au cours entre 1997 et 2001.
Dans les dernières années, soit entre 2001 et 2003, le graphique 2.1.1 laissait entrevoir une certaine recrudescence de l’emploi à temps partiel. Est-il possible qu’à la faveur des dernières années, le phénomène reprenne son ascension ? Il est difficile de le postuler, notamment parce que les causes profondes de cette évolution du travail à temps partiel, outre le prolongement des études ou la nébuleuse mutation du marché du travail, sont mal connues. Il peut s’agir de modifications des préférences agrégées des chercheurs d’emploi ou encore des stratégies de gestion des ressources humaines des employeurs axées sur la flexibilité du travail, par exemple.
Le travail temporaire
Défini comme un emploi dont la date de cessation est prédéterminée, ou dont la durée est celle d’un projet précis, le travail temporaire est aussi considéré comme un travail précaire puisqu’il n’offre aucune sécurité d’emploi. Le travail temporaire regroupe notamment le travail à contrat, occasionnel ou saisonnier.
Comme on l’a vu au tableau 2.1.1, tiré de l’avis du CPJ, il affecte davantage les jeunes. Les données du CPJ montrent aussi que le travail temporaire à temps partiel est plus fréquent chez les femmes, peu importe le groupe d’âge, alors que l’inverse est vrai pour le travail temporaire à temps plein. En 1999, ce sont 22,9 % des jeunes sur le marché de l’emploi qui occupaient un emploi temporaire. En retranchant les emplois d’été, qui sont temporaires presque par définition, cette proportion était de 16,5 % des 15-29 ans, contre 9,1 % chez les 30 ans et plus. Ce constat est similaire à celui d’André Grenier qui compare la situation globale à celles des jeunes n’étant pas étudiant. Selon lui, en 1997, les jeunes de 15 à 24 ans occupant des emplois permanents s’élevaient à 74 % alors que cette proportion était de 90 % pour les 25 ans et plus. « Toutefois, si on ne considère que les jeunes qui [n’étaient] pas étudiants, cette proportion [montait] à 81 % » [70] . L’écart défavorable aux jeunes persiste néanmoins.
Cependant, la situation n’est pas uniforme lorsqu’on considère des tranches d’âge de 5 ans. On constate en effet que la proportion de l’emploi temporaire durant la période scolaire était de 23,9 % pour les 15-19 ans, 18,9 % pour les 20-24 ans et 14,0 % chez les 25-29 ans.
Les chiffres les plus récents de Statistique Canada montrent aussi que le travail temporaire touche davantage les jeunes que les travailleurs plus âgés. Ce sont en effet 37,5 % des 15-19 ans et 24,3 % des 20-24 ans qui étaient dans cette situation en 2004, contre 9,9 % des 35-44 ans et 7,6 % des 45-54 ans. Les employés temporaires de 15-24 ans sont principalement des contractuels et des occasionnels, comme en témoigne le tableau 2.1.4 ci-dessous.
Le graphique précédent illustre l’évolution de l’emploi temporaire par groupe d’âge depuis 1997 [71] . Sur cette période, plus le groupe d’âge considéré est jeune, plus la part de travail temporaire est élevée. Quant aux écarts entre les groupes d’âge, il est intéressant de remarquer qu’ils diminuent avec l’âge. Force est de constater que le travail temporaire n’est pas une situation définitive et qu’en vieillissant, plusieurs travailleurs se trouvent des emplois permanents. Il demeure cependant inquiétant de voir que de nombreuses années peuvent être caractérisées par un statut précaire avant d’obtenir un emploi permettant davantage de sécurité et de planification à long terme.
Enfin, le travail temporaire affecte les jeunes dans le secteur des services plus que ceux du secteur de la production de biens, avec 32,5 % contre 24,5 %, comme en témoigne le tableau 2.1.5. Une exception toutefois, les travailleurs saisonniers représentent une proportion plus grande des travailleurs du secteur de la production de biens, comme on pouvait s’y attendre sachant que les activités agricoles et reliées aux ressources naturelles sont inclues dans ce secteur. Dans le domaine des services, ce sont les activités liées au tourisme qui regroupent de nombreux emplois saisonniers.
Si le secteur des services comporte plus d’emplois temporaires pour les 15-24 ans, c’est aussi le cas pour les 25-34 ans et les 35-44 ans. Ces données sont illustrées au tableau 2.1.6. On y voit que la part de l’emploi temporaire est deux fois plus élevée chez les 25-34 ans dans le secteur des services que dans celui de la production de biens. L’écart entre les parts de l’emploi temporaire pour les deux secteurs est aussi appréciable chez les 35-44 ans. Ce constat laisse croire que les jeunes actuels, qui sont surreprésentés dans le secteur des services, pourraient attendre relativement plus longtemps que leurs prédécesseurs avant de trouver un emploi permanent.
Le travail autonome
Le travailleur autonome, ou travailleur indépendant pour Statistique Canada, est son propre employeur. Sans lien d’emploi, le statut de travailleur autonome est considéré comme précaire parce que ses revenus ne sont pas garantis.
Comme on l’a vu au tableau 2.1.1, il s’agit de la catégorie d’emploi atypique où les jeunes travailleurs sont le moins nombreux et la seule catégorie où leur proportion est inférieure à celle des 30 ans et plus. Pour les deux tranches d’âge, les hommes sont davantage représentés dans le travail autonome que les femmes.
Le travail autonome, ou le travail indépendant, concerne donc moins les jeunes travailleurs. Ce constat est corroboré par André Grenier qui note que « chez les 15-24 ans, seulement 6 % des personnes occupées étaient des travailleurs indépendants [en 1997], soit la même proportion qu’en 1987 (…). Le pourcentage de travailleurs indépendants était plus élevé (9 %) chez les 15-19 ans, qui comprennent les camelots et nombre de gardiennes d’enfants. Chez les 20-24 ans, la part du travail indépendant ne s’élevait, en 1987 comme en 1997, qu’à 4 %. Chez les 25-29 ans, cette proportion montait à 9 % [en 1997, contre 7 % en 1987] » [72] . Il faut en conclure qu’il s’agit d’une catégorie du travail atypique où les jeunes sont très peu présents et que cet état de fait n’a pas véritablement évolué en dix ans.
En comparant l’évolution du travail indépendant sans aide salariée entre 1980 et 1998, comme le fait le document du CPJ, on constate que la croissance de cette catégorie de travail atypique a aussi été plus lente pour les 15-29 ans que pour les 30 ans et plus.
Quelques conséquences de l’emploi atypique
Finalement, la croissance phénoménale de l’emploi atypique dans les dernières décennies a d’abord et surtout touché les jeunes travailleurs qui y sont aujourd’hui largement surreprésentés. Les effets de cette précarité accrue sur les jeunes sont nombreux. Premièrement, l’insertion sur le marché du travail est désormais plus ardue, au moins qualitativement. Le CPJ souligne que « les taux d’obtention d’emplois permanents et à temps plein par les détenteurs de baccalauréat ont chuté de 75,2 % à 50,5 % entre 1982 et 1997 » [73] , ce qui ne laisse rien présager de bon pour ceux dont la scolarité est inférieure à ce niveau. Deuxièmement, selon le CPJ, « l’instabilité de l’emploi, l’intermittence, et (…) une plus forte compétition sur le marché du travail » [74]engendrent un prolongement de la scolarisation en attendant mieux, et un accroissement conséquent de l’endettement. Ce qui peut expliquer « qu’un nombre important de jeunes diplômés connaissent des difficultés à rembourser leurs dettes d’étude » [75]. Le report du projet familial ou les difficultés à accéder au logement sont aussi cités au nombre des impacts de la précarité.
Enfin, le déclin des revenus semble une conséquence particulièrement douloureuse de l’emploi atypique. Mais avant d’aborder la question des salaires et de la rémunération, la section suivante traitera de la durée de l’emploi, une donnée ayant aussi subi un recul ces dernières décennies, recul résultant potentiellement de la précarisation des emplois des jeunes.
2.2 La durée de l’emploi
La durée de l’emploi, soit la période pendant laquelle un employé conserve un même emploi, comporte un intérêt certain en matière de conditions de travail puisqu’elle conditionne l’accumulation de l’expérience ou de l’ancienneté, les augmentations de salaires, la progression dans une organisation et, conjointement, l’obtention d’un statut d’emploi permanent ou d’avantages sociaux, telle l’augmentation de la période de vacances rémunérées, l’accès à un programme d’assurances collectives ou un régime d’épargne retraite.
Bien entendu, l’âge joue un rôle important sur la durée de l’emploi puisque celle-ci dépend directement de la période d’activité sur le marché du travail. Cependant, il est possible d’illustrer quelques différences en matière de durée de l’emploi selon l’âge. Le tableau 2.2.1 et le graphique 2.2.1 illustrent la durée moyenne d’un emploi selon que l’emploi est à temps plein ou à temps partiel. Peu importe l’âge, la durée moyenne des emplois à temps partiel est toujours inférieure à la durée moyenne des emplois à temps plein. Cela dit, on peut aussi remarquer que l’écart entre temps partiel et temps plein s’accroît avec les tranches d’âge. Les deux catégories d’emploi offrent des conclusions intéressantes lorsqu’elles sont prises de façon isolée.
Le graphique 2.2.2 illustre l’évolution de la durée moyenne de l’emploi à temps plein pour différentes tranches d’âge. La stabilité de l’emploi à temps plein semble en effet un meilleur indicateur de changements à long terme. On y voit notamment que :
• La durée moyenne augmente lors des récessions des années 80 de 90, et ce pour toutes les tranches d’âge. On peut supposer que lorsque l’emploi se raréfie, les travailleurs favorisent davantage la stabilité et se permettent une plus grande mobilité en période de prospérité. Les variations n’ont pas nécessairement plus d’ampleur pour les 15-24 ans compte tenu des deux échelles.
• La durée moyenne suit une tendance à la hausse dans la population en général. Elle semble se raccourcir pour les plus jeunes, mais avec une moyenne de 19,9 mois en 2003 contre 22,4 mois en 1976, ce n’est pas particulièrement significatif sur une période aussi longue. Par contre, pour la même période, la hausse observée chez les 15 ans et plus a fait passer la durée moyenne de l’emploi de 91,0 mois (moins de 8 années) à 113,7 mois (9 années et demie).
Il est toutefois difficile d’affirmer que cette tendance concerne vraiment l’allongement de la durée moyenne de l’emploi. Pour les 25 à 44 ans, par exemple, cet allongement n’est pas véritablement apparent. Il est probable que la durée moyenne pour l’ensemble de la population en âge de travailler, les 15 ans et plus, se soit simplement allongée parce que les travailleurs plus âgés, qui démontrent aussi les durées moyennes d’emploi les plus longues, sont proportionnellement plus nombreux dans la population. S’ils sont plus nombreux, leurs caractéristiques pèseront plus lourd sur les résultats moyens des tranches d’âge.
Afin d’illustrer une certaine détérioration de la situation comparée des 15-24 ans par rapport aux 15 ans et plus, les tableaux 2.2.2 et 2.2.3 montrent la durée de l’emploi selon l’âge en 1976 et en 2003. Ils explicitent aussi, dans leur dernière ligne, l’écart séparant ces deux groupes d’âge. La croissance des écarts positifs pour l’emploi de durée très réduite (moins de 6 mois), plutôt que de traduire un rajeunissement de la cohorte des 15-24 ans, semble plutôt due à une précarisation accrue par des durées d’emploi de plus en plus courtes. Une étude réalisée conjointement par Statistique Canada et l’Université de l’Alberta sur la situation au Canada évalue qu’« il est probable que la diminution des taux d’embauche (avec l’augmentation de la durée d’occupation des emplois) influe sur le marché du travail des jeunes » [76] . L’allongement de la durée de l’emploi pourrait donc potentiellement traduire une certaine fermeture du marché du travail aux jeunes.
Ainsi, les statuts d’emploi précaires et la durée du travail sont deux indices démontrant que les conditions des jeunes sur le marché du travail présentent de graves lacunes susceptibles d’entacher durablement leur parcours professionnel. Les salaires et autres avantages liés aux conditions d’emploi seront traités dans les sections suivantes.
2.3 Les salaires et la rémunération
La question des salaires est au cœur des conditions d’emploi et de la vie professionnelle. On a vu que la scolarité et le secteur d’emploi sont des facteurs influençant la rémunération des jeunes comme des individus en général. Sur l’ensemble des jeunes, on constate toutefois que leurs salaires ont diminué en valeur réelle. Dans une perspective historique, entre 1967 et 1975, soit lorsque les baby-boomers ont été en âge de travailler, les gains salariaux des jeunes entrants relativement aux travailleurs déjà présents ont décliné. Ce constat, cité dans Revenus, chômage et insertion sociale des générations du Baby-boom [77] , est tiré d’une étude de Finis Welch [78] concernant les Etats-Unis, mais Monique Frappier documente le même phénomène au Québec. L’auteure suppose que ce déclin résulte en partie de l’impact de l’arrivée massive des baby-boomers sur un marché du travail éprouvant des difficultés à absorber cette nouvelle main-d’oeuvre.
En fait, nous verrons ici que ce processus ne s’est pas terminé avec le vieillissement des baby-boomers, au contraire. D’ailleurs, dans une étude de Myles, Picot et Wannell, les auteurs posent un constat similaire quant à la baisse des salaires relatifs des jeunes dans les années 80 : « pour les travailleurs de moins de 25 ans [16-24 ans], cette baisse pouvait atteindre 15 à 20 %. Inversement, les salaires relatifs des travailleurs plus âgés se sont accrus dans une proportion atteignant 15 % chez les travailleurs de 45 à 50 ans » [79] . En étudiant la répartition des rémunérations selon des quintiles allant des salaires les plus bas (quintiles inférieurs) au plus hauts (quintiles supérieurs), ils ajoutent : « comme chez les très jeunes, le transfert de la répartition des salaires vers les niveaux de rémunération inférieurs a aussi été généralisé chez les 25 à 34 ans » [80] , ce qui démontre que le phénomène touche aussi les jeunes qui sont sur le marché de l’emploi depuis un certain temps. Plus encore, cette enquête montre que cette tendance transcende les secteurs d’activité économique et les catégories professionnelles des jeunes : « Il y a eu un transfert important vers les niveaux de rémunération inférieurs des emplois à plein temps chez les 16 à 24 ans dans chaque secteur [souligné dans le texte] et chaque catégorie professionnelle de l’économie, y compris ceux qui offrent des salaires élevés. Chez les 25 à 34 ans, il y a eu un déplacement des niveaux les mieux rémunérés vers les emplois offrant des salaires moyens et ce, dans presque chaque secteur et dans de nombreuses catégories professionnelles. Ces phénomènes ont été généralisés et spectaculaires » [81] . Ainsi, ce n’est pas qu’entre 1967 et 1975 que les jeunes ont été défavorisés.
Les statuts précaires d’emploi et d’autres facteurs affectant les conditions de travail des jeunes contribuent vraisemblablement à diminuer encore leurs gains salariaux réels. Une étude de Statistique Canada, parue récemment et intitulée Les bons emplois disparaissent-ils au Canada ? [82] , présente une profusion de données utiles. Comme cette étude est particulièrement en lien avec les problématiques de l’évolution des salaires et des conditions de travail qui nous intéressent ici et qu’elle apporte un éclairage nouveau et unique sur cette question, nous ferons état de ces résultats, bien qu’ils ne concernent pas spécifiquement le Québec.
Nous postulons que la situation au Québec est semblable à celle de l’ensemble du Canada pour les données présentées. Ce postulat ne doit pas être particulièrement éloigné de la réalité, bien qu’en matière d’emploi, le Québec se situe sous la moyenne canadienne à bien des points de vue. Par contre, le Québec est une des provinces qui se situe rarement aux extrêmes contrairement à l’Ontario et l’Alberta, souvent supérieurs à la moyenne, et aux provinces maritimes, sous la moyenne. Et comme toutes les données présentées incluent les données provenant du Québec, l’écart devrait être raisonnable et nous permettre de tirer malgré tout des conclusions.
L’étude de Morissette et Johnson présente comme principal intérêt, pour ce rapport, de s’attarder largement sur la rémunération des jeunes. Ainsi, les auteurs constatent, « à l’instar des auteurs de nombreuses études antérieures, que l’écart salarial entre les travailleurs de moins de 35 ans et les travailleurs plus âgés s’est nettement accru depuis 20 ans » [83] . De façon plus précise, ils soulignent : « Ainsi que le démontrent de nombreuses études (…), les gains des jeunes travailleurs ont nettement diminué par rapport à ceux des travailleurs plus âgés dans les années 1980 (…). On peut donc voir que les proportions respectives d’hommes et de femmes de moins de 35 ans occupant des emplois mal rémunérés [salaire horaire inférieur à 10 $] et de 35 ans et plus occupant des emplois bien rémunérés [salaire horaire de 25 $ et plus] ont augmenté l’une et l’autre » [84] . Par exemple, le tableau 2.3.1 suivant démontrent que les jeunes travailleurs sont plus faiblement rémunérés dans une plus grande proportion que les travailleurs plus âgés.
La proportion des jeunes travailleurs qui est faiblement rémunérée est plus importante en 2004 qu’en 1986, tant chez les femmes que chez les hommes. Les 17-24 ans sont faiblement rémunérés dans une proportion particulièrement élevée. Bien que la situation des 25-34 ans soit moins pénible que celle des plus jeunes, elle demeure moins enviable que celle des 35-64 ans. Lorsqu’on considère les deux groupes d’âge combinés, soit les 17-34 ans, on observe que la fréquence de faible rémunération chez les hommes passe de 26,0 % à 32,9 %, alors que chez les femmes, elle passe de 39,4 % à 41,9 %. Autrement dit, les femmes sont encore plus nombreuses à être faiblement rémunérées que les hommes, mais ce sont ces derniers qui ont connu la plus grande détérioration entre 1986 et 2004, réduisant ainsi l’écart entre les sexes. Notamment, il est intéressant d’observer que la fréquence de la faible rémunération à quelque peu diminuer chez les femmes de 25 à 34 ans (-1,1 point de pourcentage), ce qui ne renverse toutefois pas la tendance générale puisque l’augmentation chez les hommes de cet âge (+1,9 point de pourcentage) excède cette diminution.
Le tableau précédent offre enfin un constat particulièrement percutant et utile pour notre analyse prospective des conditions d’emploi des jeunes. En effet, ces données démontrent d’une part que la part de la main-d’œuvre âgée de 17 à 35 ans a diminué entre 1986 et 2004 et, d’autre part, que leurs conditions salariales se sont détériorées au cours de cette période. Dans une perspective de déclin démographique, les jeunes représenteront une proportion encore plus faible de la main d’œuvre dans l’avenir. Toutefois, en regard des données du tableau 2.3.4, il est pour le moins présomptueux d’assumer que la pénurie de jeunes puisse engendrer une amélioration notable des salaires puisque ce ne fut pas le cas ces dernières années.
Une autre étude de Statistique Canada réalisée par René Morissette, en 1996, parvenait à des constats similaires quant à la détérioration de la situation salariale des jeunes [85] . En effet, les données présentées dans cette étude montraient que les salaires horaires réels pour les employés à temps plein avaient connu des évolutions fort dissemblables en fonction des groupes d’âge. De façon générale, le portrait est d’autant plus négatif que le groupe d’âge considéré est jeune. Dans le cas des 25-34 ans, les salaires horaires réels ont reculé entre 1981 et 1986, avant de remonter brièvement jusqu’en 1988, puis ils sont redescendu jusqu’à la fin de la période étudiée pour atteindre, en 1993, 93 % de ce qu’ils étaient en 1981. Le même découpage peut être fait pour les 17-24 ans, le plus jeune groupe d’âge considéré dans cette étude. Toutefois, le recul enregistré entre 1981 et 1986 a été beaucoup plus prononcé, les salaires horaires réels reculant de près de 20 %. Si la reprise à la hausse entre 1986 et 1988 a été légèrement plus forte pour les 17-24 ans que pour les 25-34 ans, la période de 1988 à 1993 fut aussi plus négative. En 1993, les salaires horaires réels des 17-24 ans n’atteignaient plus que 78 % du niveau de 1981. Pour tous les autres groupes d’âge, les salaires horaires réels ont augmenté entre 1981 et 1993.
Causes des pertes salariales des jeunes et rattrapage
Certains auteurs se sont penchés sur les causes possibles de ce recul des salaires réels et relatifs des jeunes. Une étude réalisée par Garnett Picot observe que les pertes salariales qu’ont connues les jeunes dans les années 80 et 90 sont occasionnées par des diminutions de leurs salaires réels : « contrairement à ce qu’on observe pour la population dans son ensemble, la diminution des gains des jeunes est liée en grande partie à la diminution de la rémunération horaire, plutôt qu’à la baisse relative du nombre d’heures de travail. On constate une tendance à la baisse de la rémunération horaire réelle des jeunes » [86] . Contrairement à Monique Frappier qui constatait une diminution des salaires relatifs des jeunes par rapport aux travailleurs plus âgés, il s’agit ici d’une baisse des salaires réels. Picot situe d’ailleurs le début de cette baisse en 1977, accentuée par la suite lors de la récession des années 80 [87] . En bref, il faut retenir que les jeunes ne travaillent pas moins, mais ils sont moins rémunérés pour leur travail.
Picot fait état de quelques thèses portant sur les causes et les conséquences de ces pertes salariales. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas spécifique au Québec ou au Canada, mais est observé dans l’ensemble de l’OCDE. Pour ce qui est des causes, Picot cite une thèse énoncée par S.J. Davis [88] , du National Bureau of Economic Research des Etats-Unis, selon qui l’évolution technologique engendre une prime à l’expérience de plus en plus importante. Picot est cependant d’avis que « les corrections de tout type se marquent ordinairement davantage chez les jeunes travailleurs » [89] . En effet, réduire les salaires des travailleurs plus âgés comporte un risque « car les employeurs craignent l’effet d’une telle mesure sur le moral et la productivité. En fait, on constate depuis un certain temps l’inélasticité des salaires aux pressions négatives » [90] . Ainsi, il est plus simple de réduire les salaires des nouveaux employés afin de préserver les acquis des travailleurs ayant de l’ancienneté.
Madeleine Gauthier avance pour sa part l’explication des secteurs d’emploi : « les secteurs d’emploi où sont entrés les jeunes ont connu une rémunération à la baisse alors que ceux où se trouvent les travailleurs de quarante-cinq ans et plus ont connu une hausse » [91] . Elle s’appuie à ce propos l’étude de Myles, Picot et Wannel de 1988 citée au début de cette section.
Outre l’expérience, la scolarité est un facteur qui influence aussi la rémunération. Puisque les jeunes d’aujourd’hui disposent d’une scolarité élevée, on serait porter à croire que cet atout leur permettrait de rattraper leur retard salarial. Or, les baby-boomers ont aussi un bon niveau de scolarité, généralement. Ce niveau était bien supérieur à celui de leurs aînés. Mais « l’avantage d’une scolarité plus poussée qu’ont eu les jeunes travailleurs à une époque a pratiquement disparu au cours des années 90 » [92] . Il s’agit de la thèse de l’évolution des écarts dans la scolarité des cohortes, selon laquelle une génération disposant d’une scolarité plus élevée que la génération précédente est à même de faire contrepoids à son manque d’expérience professionnelle. Comme le note aussi Madeleine Gauthier, puisque les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas notablement plus scolarisés que la génération précédente, « l’effet de l’âge retrouve ici ses droits » [93] . Picot cite, pour sa part, l’étude de Beaudry et Green de 1996 selon laquelle « ce décalage [de salaires] a lieu pour tous les niveaux de scolarité. Avoir décroché un diplôme universitaire n’a pas protégé les jeunes contre ce glissement vers l’extrémité inférieure de la courbe de répartition des gains en fonction de l’âge » [94] . Autrement dit, la scolarité ne permettrait pas de contourner ces baisses salariales.
La thèse de l’évolution des écarts dans la scolarité des cohortes est aussi explorée dans une étude de Kapsalis, Morissette et Picot, pour le compte de Data Probe Exonomic Consulting Inc. et de Statistique Canada [95] . Selon cette étude, si les écarts salariaux augmentent entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés, les différences dans la progression du niveau de scolarité expliquent entre 25 % et 33 % de cet accroissement. Actuellement, il semble que la progression du niveau de scolarité de la jeune génération ne soit pas substantielle comparée à la génération précédente et contribue peu ou pas aux variations salariales observées.
Enfin, si les jeunes ont connu un important recul de leur rémunération durant ces dernières décennies, la jeunesse se passe et les jeunes d’aujourd’hui ne finiront-ils pas par accumuler une expérience professionnelle pouvant leur permettre de rattraper leur retard ? Au contraire, les pertes salariales pour les jeunes apparaissent « d’autant plus préoccupante(s) que, selon notre analyse longitudinale, les cohortes plus jeunes ne « rattrapent » pas les cohortes plus âgées à mesure qu’elles avancent en âge et acquièrent de l’expérience » [96] , selon Picot. Ce résultat s’est vérifié aussi dans une nouvelle étude de Beaudry et Green [97] , mentionnée dans l’avis sur le travail atypique du CPJ. Selon leurs résultats, les deux auteurs prévoient que la différence de salaire entre les jeunes d’aujourd’hui lorsqu’ils seront âgés de 50 ans et la cohorte précédente sera d’environ 200 $.
Ainsi, les jeunes semblent systématiquement défavorisés sur le marché du travail en termes de rémunération. Comme le montre la section suivante, le salaire n’est pas la seule condition d’emploi à ne pas leur être favorable.
2.4 Les régimes de pension
La participation à un régime de pension représente le principal avantage non salarial dans l’étude des conditions d’emploi. Mais, contrairement au salaire et au statut d’emploi, les régimes de pension ont une incidence seulement sur des périodes de temps assez longues et les conséquences immédiates de la participation à un régime de pension ne sont pas évidentes pour les jeunes travailleurs. Il ne s’agit donc pas d’un aspect important de ce rapport. Trois aspects méritent toutefois d’être soulignés brièvement, soit la baisse de participation à des régimes de pension chez les jeunes travailleurs, les hausses de cotisation dans les dernières années et les inquiétudes sur la pérennité des régimes dues au vieillissement de la population.
La diminution de participation des jeunes travailleurs aux régimes de retraite, un constat largement partagé, doit être nuancé selon les sexes. Comme le constate une étude de Morissette et Drolet, réalisée pour Statistique Canada, « la protection offerte par les régimes de pension a baissé parmi les jeunes hommes : en 1984, 51 % des hommes travaillant à temps plein âgés de 25 à 34 ans avaient un RPA [Régime de pension agréé fournit par l’employeur], comparativement à 45 % seulement en 1993. Le déclin est encore plus marqué parmi les hommes âgés de 17 à 24 ans (de 28 % en 1984 à 19 % en 1993) » [98] . Pour les jeunes femmes travaillant à temps plein, le constat est quelque peu différent : « contrairement aux hommes, les femmes âgées de 25 à 34 ans ne semblent pas subir une baisse de la protection offerte par un RPA, du moins jusqu’en 1995. (…) Tout comme les hommes, les femmes âgées de 17 à 24 ans ont vu leur protection diminuer » [99] . Cette étude attribue cette diminution de la protection offerte à une syndicalisation plus faible des jeunes travailleurs, et au déplacement du secteur de la fabrication vers les secteurs des services aux consommateurs et aux entreprises. Les auteurs remarquent aussi que les jeunes hommes détenteurs d’un diplôme universitaire n’ont pas été atteints par ce phénomène. Ces résultats sont aussi corroborés par l’étude de Morissette et Johnson [100] datant de 2005. Notons aussi qu’il s’agit de statistiques concernant uniquement les travailleurs à temps plein, excluant bon nombre de jeunes à statut précaire.
Il semble important de noter ici que ces résultats proviennent de données canadiennes et qu’en matière de régimes de retraite, le Québec fait bande à part de par la présence de la Régie des rentes du Québec (RRQ) et de spécificités diverses. Cette question se complique aussi du fait que certains régimes offrent des prestations déterminées lors de la retraite alors que d’autres sont basées sur des contributions déterminées durant la vie active. Lorsqu’on prend en compte ce critère spécifique, les experts semblent s’entendre pour dire que la baisse marquée des régimes à prestations déterminées est un recul qualitatif important, un changement qui affectera aussi les jeunes travailleurs dans les années à venir.
En ce qui concerne la pérennité des régimes de retraite, de nombreuses informations contradictoires circulent, d’autant plus qu’un débat important a lieu par le biais des médias où les caisses de retraite se veulent rassurantes. Aussi est-il hasardeux de se prononcer sur ces questions autrement que pour souligner les inquiétudes, fondées ou non, qu’entraîne le vieillissement de la population. Toutefois, rappelons que les cotisations aux régimes de pension ont augmenté considérablement ces dernières années, suite à la réforme de 1997, sans que les bénéfices n’en soient bonifiés.
Bien qu’il s’agisse d’une problématique de moindre importance dans le cadre de ce rapport, les recherches visant à anticiper les conséquences des bouleversements dans les régimes de retraite au Québec sur les jeunes travailleurs devraient à notre avis être poursuivies. Dans une perspective à long terme, il s’agit d’une question qui affectera durablement les jeunes travailleurs d’aujourd’hui lorsque ceux-ci seront à la retraite.
2.5 La syndicalisation chez les jeunes
La couverture syndicale représente moins un descriptif des conditions d’emploi qu’un facteur déterminant ces conditions. Principalement, on associe aux postes syndiqués une plus grande sécurité d’emploi, un meilleur salaire, des avantages sociaux plus généreux et une protection plus efficace contre les abus. C’est pourquoi la couverture syndicale des jeunes travailleurs peut se révéler un indice supplémentaire concernant les conditions d’emploi, bien qu’elle ne soit pas directement synonyme de meilleures conditions d’emploi.
La situation au Canada est marquée par un « taux de syndicalisation relatif des nouveaux employés [ayant] chuté de façon drastique entre 1981 et 1998 » [101]. Rappelons que les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas tous des jeunes, et la situation canadienne est ici moins similaire à la situation propre au Québec. Un article d’Akyeampong [102] atteste d’ailleurs une hausse de la syndicalisation des jeunes canadiens ces dernières années. Cette hausse du taux de syndicalisation, de 10,8 % en 1997 à 13,5 % en 2003 pour les 15-24 ans, est certes appréciable bien que leur situation demeure largement inférieure aux situations des autres groupes d’âge. À titre d’exemple, l’auteur indique un taux de syndicalisation de 33,4 % pour les 25 à 54 ans en 2003.
Pour ce qui est précisément du Québec, « la syndicalisation chez les jeunes est (…) plus faible que chez leurs aînés. Le taux de couverture syndicale chez les employés rémunérés de 15 ans et plus était de 42 % au Québec en 1997, selon l’Enquête sur la population active. Il atteignait 46 % chez les travailleurs de 25 ans et plus, mais n’était que de 19 % parmi les 15-24 ans. Seulement 13 % des 15-19 ans étaient couverts par une accréditation syndicale, proportion qui monte à 22 % chez les 20-24 ans, soit la moitié de la couverture des 25 ans et plus » [103] . Ces données sont illustrées dans le graphique 2.5.1 ci-dessous.
Bien que les données utilisées pour calculer ces proportions portent sur tous les jeunes, sans égard à leur statut d’étudiant par exemple, il semble bien que le taux de syndicalisation des jeunes qui ne sont pas aux études « demeure nettement en deçà de celui des employés de 25 ans et plus [104] » . Ainsi, on ne peut conclure qu’il y a une évolution à la baisse de la syndicalisation chez les jeunes travailleurs. Selon Emploi-Québec, on observe même une hausse depuis 1998 qui n’est pas observée chez les 25 ans et plus. Il demeure néanmoins certain que ceux-ci sont largement moins couverts par une protection syndicale que leurs aînés. Étant donnée la relation entre la syndicalisation et les conditions d’emploi, il s’agit ici d’un indice que celles-ci sont plus susceptibles d’être précaires chez les jeunes travailleurs.
2.6 Conclusion
Après avoir établi les caractéristiques relatives au marché du travail des jeunes Québécois en général au chapitre précédent, les constats du présent chapitre sur les conditions d’emploi portaient plus spécifiquement sur les jeunes travailleurs. Ainsi, les études et données consultées permettent d’affirmer que les conditions des jeunes sur le marché du travail se sont profondément transformées au cours des dernières décennies. L’emploi atypique a connu une progression impressionnante au cours des années 80 et touche d’abord les jeunes. Le travail à temps partiel involontaire décline depuis 1997 à la faveur d’une bonne conjoncture économique, certes, mais il demeure que ce phénomène a pris de l’ampleur depuis 1976. La durée moyenne des emplois des jeunes, quant à elle, ne suit pas la tendance à la hausse observée dans le reste de la population et, au contraire, semble avoir diminué entre 1976 et 2003. Pour ce qui est des salaires, la détérioration des conditions d’emploi des jeunes apparaît clairement dans les données, sans être compensées par une hausse conséquente des autres bénéfices comme les régimes de pensions, au contraire. Le travail précaire, leur faible couverture syndicale et le déplacement de l’emploi des jeunes vers le secteur des services, surtout dans les domaines les moins rémunérateurs, peuvent expliquer cette tendance préoccupante.
Est-il possible que ces transformations du marché du travail ne soient qu’une période temporaire tirant à sa fin et que la situation ait toutes les chances de s’améliorer dans les années à venir ? Pour tenter de répondre à cette question, le chapitre suivant portera sur les perspectives futures des jeunes sur le marché du travail.
Chapitre 3 : Les perspectives d’emploi dans les années à venir
Après avoir brossé un portrait des jeunes Québécois et, plus spécifiquement, des jeunes travailleurs, l’objet de ce dernier chapitre est de faire état des tendances qui pourraient déterminer ce que sera le marché du travail dans les années à venir. Cette question prend une importance particulière pour les jeunes puisque « l’adaptation à l’évolution de la demande de main d’œuvre dans les diverses professions et les divers secteurs se concentre sur les jeunes » [105] . Nous avons déjà vu, à ce titre, que les jeunes se retrouvaient davantage dans le secteur des services que les autres groupes d’âge à la section 1.3, ou encore qu’ils étaient surreprésentés dans les emplois atypiques, sans doute en raison de leur flexibilité face aux transformations de l’emploi.
Cependant, l’évaluation prospective demeure un exercice toujours risqué. D’une part, pour extrapoler une tendance dans les années à venir, il faut bien saisir les facteurs qui la sous-tendent. Par exemple, à défaut de pouvoir prédire les variations de la conjoncture économique, il serait vain de projeter les niveaux de chômage des jeunes. Or, les changements qui ont cours sont nombreux. Entre la tertiarisation des emplois, la scolarité plus élevée, la féminisation du marché du travail, la mondialisation des échanges commerciaux, l’avènement des technologies de l’information et des télécommunications ou l’émergence de l’économie du savoir, le Québec a connu plusieurs changements structurels. De plus, ces transformations interagissent entre elles. Ainsi, « il apparaît difficile de distinguer les effets de plusieurs facteurs, dont les changements technologiques, les stratégies d’entreprises ou de pays et la mondialisation » [106] .
L’autre difficulté majeure de l’évaluation prospective réside dans l’évaluation faite de la situation actuelle. L’état actuel de l’économie, du marché du travail ou de la scolarisation détermine en partie le degré d’optimisme ou de pessimisme qu’un observateur adopte vis-à-vis l’avenir. Il est toutefois possible d’étudier les déterminants de la situation professionnelle des jeunes, bien que la conjoncture, actuellement favorable, puisse camoufler des difficultés structurelles des jeunes, comme nous le soulignions au début de la section 1.3.
3.1 Évaluation de la situation actuelle et démographie
Pour entamer cet exercice d’évaluation prospective, nous récapitulerons quelques éléments marquants de la situation actuelle. Il est certainement possible de dire que l’économie et le marché du travail du Québec se portent bien comparativement à d’autres États. C’est aussi le cas dans une perspective historique comme nombre d’éléments abordés dans les chapitres précédents l’illustraient.
Voici quelques constats généraux sur l’état actuel de l’économie et du marché du travail du Québec [107] qui stimulent l’optimisme :
• La croissance économique continue depuis de début des années 90 a fait croître le PIB réel du Québec de 41,2 % entre 1991 et 2004 ;
• Malgré la hausse du dollar, la catastrophe attendue ne s’est pas produite et, bien que certains secteurs souffrent plus que d’autres, les exportations québécoises ont augmenté en 2004, mettant fin au recul de 2001 à 2003 ;
• La productivité est à la hausse depuis 1994 [108] , sauf en 2004. Selon le Centre d’étude sur les niveaux de vie, entre 1994 et 2003, cette hausse a atteint 16,2 % ;
• Après avoir diminué en 1991 et en 1992, le nombre de personne en emploi a augmenté de plus de 600 000 entre 1992 et 2004, contribuant à faire passer le chômage de 12,8 % à 8,5 % ;
• La durée du chômage elle-même est plus courte en 2004 que dans les années précédentes, comme on l’a vue au graphique 1.3.3 ;
• Sur le plan budgétaire, les déficits du Québec sont minimes et les frais de la dette sont au plus bas grâce à la faiblesse des taux d’intérêt.
Par contre, nombre de ces données reposent sur une conjoncture favorable et ne justifient pas une confiance débordante envers l’avenir. Il faut aussi noter que :
• La rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 670,44 $ par semaine en 2004, mais la hausse réelle depuis 1991 est nulle comparée à l’inflation ;
• La croissance économique est soutenue notamment par la consommation, grâce aux taux d’intérêt avantageux, mais qui pourraient bien remonter dans les prochaines années ;
• Cette remontée gonflerait aussi le service de la dette et exercerait une pression importante sur l’équilibre budgétaire déjà précaire, notamment parce que notre dette est élevée et continue de s’accroître ;
• Les rentrées fiscales en provenance des particuliers sont en diminution et les coûts de la santé sont à la hausse, accaparant une part toujours plus grande des dépenses gouvernementales ;
• Enfin et surtout, le Québec entrera bientôt dans une longue période de déclin démographique.
La situation démographique
Au premier plan des tendances qui influenceront le monde du travail dans les années futures, il y a la démographie du Québec. La vague du baby-boom se trouve déjà bien près de la sortie du marché du travail [109] , comme l’illustre le graphique 3.1.1. Cet élément, combiné à la baisse de la natalité, bien visible dans la pyramide des âges, entraînera vraisemblablement le déclin de la population en âge de travailler, soit les 15-64 ans, ainsi que de la population totale à plus long terme.
Les projections démographiques réalisées par l’Institut de la statistique du Québec [110] (ISQ) prévoient que la diminution des 15-64 ans débutera aussi tôt qu’en 2008. Pendant les années qui vont suivre, la proportion des 15-64 ans dans la population totale va décroître, une tendance illustrée par le graphique 3.1.2. Cette donnée est importante dans le sens où les taux d’activité des 65 ans et plus sont toujours très bas, la vaste majorité de ce groupe d’âge étant à la retraite. Les 15-64 ans regroupent au contraire les groupes d’âge dont les taux d’activité sont les plus élevés. Le graphique 3.1.2 prédit pour ainsi dire une diminution de la main d’œuvre dans la population du Québec. On voit en effet que de son sommet de 69,7 % de la population totale, les 15-64 ans représenteront moins de 60 % après 2030, une chute de 10 points de pourcentage en 20 ans.
La population totale ne diminuera pas pour autant avant 2031, essentiellement parce que les 65 ans et plus seront de plus en plus nombreux. Pour illustrer la proportion croissante de ces derniers parmi la population, les graphiques 3.1.3 et 3.1.4 montrent le poids relatif des différents groupes d’âge parmi les 15 ans et plus, actuellement et en 2031.
On y voit que tous les groupes d’âge des 15-64 ans se trouvent en quelque sorte comprimés par l’accroissement des 65 ans et plus, qui passeront de 22,9 % à 38,3 % des 15 ans et plus. La proportion des jeunes de 15 à 34 ans diminuera quant à elle de 31,1 % aujourd’hui à 24,4 % en 2031.
Le déclin des jeunes évoqué dans ces projections concerne les années à venir. Il semble toutefois pertinent de souligner que cette tendance est déjà pleinement amorcée. Comme on le voit au graphique 3.1.5 qui suit, le poids relatif des 15-34 ans diminue déjà depuis 1980, soit depuis 1977 pour les 15-24 ans et depuis 1988 pour les 25-34 ans.
Ce déclin précoce des tranches d’âge les plus jeunes traduit la baisse de la natalité au Québec depuis la fin du baby-boom. Dès 1981, la tranche d’âge des 15-34 ans comprenait moins d’individus qu’auparavant. L’évolution des 15-34 ans en termes absolus de 1971 à 2004 est représentée par le graphique 3.1.6.
En dernier lieu, précisons que les tendances dont il est question ici ne toucheront pas uniformément les régions du Québec. En fait, avant même que la population québécoise ne diminue, certaines régions auront déjà perdu une proportion appréciable de leur population. Le graphique 3.1.8 fait état des variations démographiques attendues pour chaque région entre 2001 et 2026.
Des sept régions [111] qui seront en décroissance démographique d’ici 2026, six ont déjà des taux migratoires négatifs, tel que représenté au graphique 1.3.5. Seule la Mauricie fait exception à cette corrélation.
Les conséquences du déclin démographique québécois sur le marché du travail ne sont pas encore évaluées avec certitude. Il semble toutefois acquis que ces conséquences seront profondes. Le CETECH s’est attaqué à la tâche de tracer un portrait des tendances lourdes qui se font sentir sur le marché du travail.
3.2 Tendances dans le marché du travail pour les années à venir
D’un point de vue général, il peut être difficile de rendre compte de l’état futur du marché du travail notamment parce que des pénuries de main d’œuvre dans certains domaines peuvent côtoyer des pénuries d’emploi dans d’autres domaines. Cependant, l’évolution démographique du Québec ou les tendances des dernières années en matière de scolarisation peuvent contribuer à comprendre quelques changements probables.
Les perspectives d’emploi par sexe
La présence accrue des femmes sur le marché du travail est une tendance bien connue des dernières décennies. Le graphique 3.2.1 illustre d’ailleurs la convergence des sexes en matière d’emploi. Entre 1976, où elles occupaient 35 % des emplois, et 1996, année où ce pourcentage atteignait presque 45 %, la place des femmes sur le marché du travail a largement progressé. Dans les dernières années, la tendance s’est maintenue tout en ralentissant. Bien que le graphique 3.2.1 ne présente pas une ligne de temps continue, on voit que le rattrapage était plus important dans les premiers temps, alors que l’augmentation de la part des femmes entre 1991 et 1996, ou entre 1996 et 2001, est plus ténue. Chez les 15-34 ans, la part de l’emploi occupée par des femmes atteint presque le 50 % en général et le dépasse pour les emplois demandant des études postsecondaires.
La scolarité élevée des jeunes femmes peut encore faire augmenter leur taux d’activité et leur taux d’emploi. Dans une perspective démographique, la hausse de la participation des femmes au marché du travail est une bonne nouvelle car elle peut contribuer à atténuer la décroissance de la population active.
Les perspectives d’emploi des jeunes
On sait déjà que les jeunes représentent une proportion plus faible des emplois que par le passé en raison de la baisse du taux de natalité. On a vu aussi qu’ils éprouvent toutes sortes de difficultés sur le marché du travail, notamment le fort taux de chômage des 15-24 ans. Pour ce qui est des jeunes travailleurs, ils se retrouvent fréquemment dans des emplois précaires. Heureusement, la stagnation de la part de l’emploi atypique dans les années 90 préfigure possiblement d’une croissance reposant davantage sur l’emploi typique dans les années à venir, du moins tant que la conjoncture économique demeurera favorable. Mais si le développement de l’emploi atypique repose plutôt sur des stratégies d’entreprises répandues, visant à rendre leur main d’œuvre plus flexible, les emplois précaires constitueront toujours un phénomène important et risquent peu de régresser. Il ne faut pas oublier que l’emploi atypique demeure involontaire dans bien des cas et affecte durablement l’insertion professionnelle des jeunes.
Par ailleurs, lorsqu’on compare la proportion d’emplois occupés par les jeunes avec leur proportion dans la population en âge de travailler, on constate qu’ils occupent généralement une moins grande proportion des emplois que leur poids au sein de la population. Et on peut se rappeler que les emplois occupés par ces jeunes sont qualitativement moins intéressants, ce que ne précisent pas les données suivantes. Dans le graphique 3.2.2, les deux courbes se suivent et la proportion des emplois occupés par des 15-34 ans est même supérieure à leur poids démographique en 1986. Toutefois, entre 1996 et 2004, l’écart est plus important qu’avant.
L’accroissement de la fréquentation scolaire explique en partie cet écart puisque qu’il fait diminuer le taux d’activité des 15-34 ans. D’un autre côté, bon nombre d’étudiants travaillent tout de même. Il demeure néanmoins intéressant de constater que la tendance générale de la part des emplois occupés par les jeunes est à la baisse, tout comme leur poids démographique, si ce n’est davantage. Ceci pourrait signifier que les employeurs ne maintiennent pas les rythmes d’embauche des dernières décennies. Si cela avait été le cas et que les employeurs se seraient souciés de leur relève, l’évolution de la proportion des jeunes en emploi n’aurait vraisemblablement pas eu cet aspect. Dans une perspective de raréfaction de la relève, il est déjà étonnant que la situation des jeunes se soit détériorée ces dernières années.
Une analyse intéressante sur ce sujet est proposée par Gabriel Laroche, économiste au CETECH. Il souligne ainsi que « les analystes du marché du travail savent que le vieillissement de la main d’œuvre qui est déjà en cours (…) demeure un facteur de stabilité des emplois, sinon d’une certaine rigidité du marché du travail. Les travailleurs âgés sont naturellement moins portés à changer d’emploi volontairement, ce qui avec leur nombre croissant devrait avoir un impact sur la flexibilité et le dynamisme du marché du travail. (…) un marché du travail plus ou moins flexible n’est pas sans conséquence au plan de la productivité et de l’aptitude à intégrer de nouveaux venus » [112] . Si tous les ajustements d’un marché du travail ayant un grand besoin de flexibilité se reportent sur les jeunes parce que les travailleurs plus âgés sont nombreux et moins flexibles, les difficultés professionnelles que connaît actuellement la jeunesse risquent de perdurer encore longtemps en regard des tendances démographiques.
Par contre, puisque les jeunes présentent une scolarité élevée et qu’il s’agit d’un facteur puissant en matière d’emploi, il faut étudier les perspectives d’emploi selon la scolarité pour mieux prévoir les tendances qui affecteront les jeunes.
Les perspectives d’emploi selon la scolarité
De façon générale, la scolarité représente sans doute le facteur par excellence conditionnant l’insertion professionnelle des jeunes. En effet, le parcours scolaire d’un individu influence notablement le risque du chômage, son statut d’emploi entre les emplois plus stables et les emplois atypiques, l’espérance de sa rémunération, etc. Le CETECH a toutefois produit une analyse intéressante en mesurant la croissance de la scolarité dans la population et la croissance des emplois selon les compétences demandées. Le graphique 3.2.3 reproduit le graphique produit par le CETECH [113].
Comme on le voit sur ce graphique, ce sont les emplois exigeant davantage de scolarité qui ont augmenté le plus alors que les emplois sans qualification requise ont chuté. Cette tendance profonde, et commune à la plupart des pays industrialisés, engendre d’importants besoins en main d’œuvre hautement qualifiée [114]. Les données du CETECH confirment la hausse de la scolarité, et surtout la hausse de la fréquentation universitaire qui est telle que le nombre d’inscription augmente en dépit de la décroissance démographique des groupes d’âge les plus jeunes, surtout à la maîtrise et au doctorat. A contrario, le taux d’accès aux études collégiales techniques stagne depuis une quinzaine d’années et le nombre de diplômés diminue [115].
On constate aussi que les diplômés universitaires ont connu une croissance supérieure à celle des emplois de leur catégorie. Cet écart signifie qu’il y avait plus de diplômés par poste en 2002 qu’en 1990. Au contraire, les diplômés du secondaire sont moins nombreux par poste et la compétition à leur niveau a diminué au cours de cette période malgré la diminution des emplois de ce niveau. Il est d’ailleurs souligné dans le rapport que « toutes les données que [les auteurs ont] consultées semblent indiquer un tel rétrécissement de l’avantage conféré par la scolarité, en termes d’intégration en emploi, au cours des dernières années » [116]. Est-il possible que la valeur des diplômes soit à la baisse en termes d’insertion professionnelle ? Le phénomène de l’inflation des titres scolaires pourrait bien en être une manifestation.
3.3 Tendances liées à la scolarité
L’impact professionnel de la scolarité dans les dernières années est toujours positif, mais montre quelques signes inquiétants, dont l’inflation des titres scolaires et la surqualification. Par ailleurs, le déclin démographique de la population active pourrait présenter le risque de faire apparaître des pénuries de main d’œuvre, sujet dont nous traiterons à la fin de cette section.
La valeur de la scolarité et l’inflation des titres scolaires
Un diplôme atteste que son détenteur a acquis des compétences et qu’il a fait preuve « de capacités cognitives qui prédisposent à un apprentissage en emploi » [117]. Les employeurs s’en servent pour distinguer les employés potentiels. Mais lorsque la compétition se fait plus forte et que les diplômés sont nombreux, peut-on encore voir le diplôme comme une garantie d’une vie professionnelle sans tache ? Par exemple, on a vu que la question de la rémunération appelle une nuance majeure, soit que malgré une scolarité plus poussée, un jeune risque malgré tout d’obtenir une rémunération inférieure à ce que cette même scolarité signifiait pour les générations précédentes.
Fournier et al. considèrent d’ailleurs que l’importance du diplôme pour l’insertion professionnelle doit être interprété avec une certaine prudence. Premièrement, l’endettement accumulé par certains jeunes pour financer leur scolarité ainsi que « les conditions précaires d’emploi viennent prolonger la période où les jeunes doivent se satisfaire de conditions de vie modestes » [118]. Comme nous avons déjà traité de l’endettement au premier chapitre, nous ne reviendrons pas sur ce thème.
Deuxièmement, « l’accroissement du taux de scolarité a progressivement favorisé une inflation des titres scolaires et a occasionné une plus forte concurrence entre les compétences sur le marché du travail » [119]. Le phénomène ne serait pas nouveau à en croire Monique Frappier. À partir du Baby-boom, on observe dans certains pays une « inflation et [une] dévaluation des diplômes », selon Olivier Galland, dans une étude française de 1985 [120]. Selon Monique Frappier, le phénomène est aussi observable au Canada et au Québec pour la même période.
L’inflation des titres scolaires, déjà abordée au premier chapitre, a pour conséquence que, « paradoxalement, depuis plusieurs années, des générations de plus en plus diplômées s’insèrent de plus en plus mal, même si la reprise économique de 1997 semble manifester une certaine « embellie » des conditions d’insertion » [121]. Le Conseil permanent de la jeunesse, citant une étude de Statistique Canada, affirme aussi qu’« il est évident que les jeunes qui tentent d’entrer dans presque tout secteur d’activités de nos jours doivent posséder des qualifications professionnelles de beaucoup supérieures à celles de leurs parents il y a 20 ans » [122]. D’un point de vue économique, le coût des études demeure semblable, tant sur le plan financier que sur le plan des efforts personnels qu’elles exigent, mais les bénéfices de la scolarisation décroissent.
Une cause potentielle de l’inflation des titres scolaires réside dans l’évolution des emplois selon les niveaux de scolarité demandés telle que vue plus haut. Il est aussi possible que le manque d’expérience professionnelle des diplômés les pousse à accepter des emplois pour lesquels ils sont trop qualifiés, ce qui revient aussi à la situation dans laquelle il faut étudier davantage qu’auparavant pour espérer obtenir un emploi donné.
Les diplômés surqualifiés
En troisième lieu, Fournier et al. font état d’une tendance nuançant aussi la valeur des diplômes. En dépit de l’endettement causé par les études, et sans doute en raison de l’inflation des titres scolaires, « il n’est pas rare de voir des jeunes accepter au début de leur carrière des emplois ne correspondant pas à leur formation initiale, souvent en deçà de leurs compétences et ne répondant presque pas à leurs attentes » [123]. Le processus conduisant des diplômés à accepter des emplois pour lesquels ils sont trop qualifiés, qu’on nomme le « déclassement », provoque le même type d’effet pour tous ceux qui sont moins qualifiés et qui en sont aussi réduits à accepter des emplois sous leur niveau de compétence.
La main d’œuvre surqualifiée a fait l’objet d’un article de Gabriel Laroche dans le Bulletin du CETECH [124]. En répartissant les diplômés selon des niveaux de compétence des emplois occupés, l’auteur parvient à un portrait de la surqualification qui affecte les diplômés. Ainsi, environ 37 % des diplômés collégiaux, hommes ou femmes, occuperaient un emploi exigeant moins que leurs compétences. Chez les bacheliers, 23 % des hommes et 28 % des femmes se trouveraient dans cette situation. Les détenteurs de maîtrises seraient particulièrement touchés, 62 % des hommes et 55 % des femmes de ce niveau étant surqualifiés pour le poste occupé.
Ce phénomène n’est pas unique au Québec : « en ce qui concerne l’ampleur ou l’incidence du phénomène, le taux moyen de suréducation est établi à 26 % [en Europe et en Amérique] » [125]. Compte tenu que les emplois hautement qualifiés ont connu une croissance inférieure à celle des diplômés, il se crée une rareté relative des emplois de ce type. Ainsi, ce n’est pas parce que les emplois de leur niveau sont de meilleure qualité que les diplômés ne les occupent pas, mais bien parce que la compétition accrue résultant de cette rareté relative pousse une partie d’entre eux vers des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés.
D’un certain point de vue, la surqualification est un moindre mal puisqu’elle évite au diplômé de tomber au chômage. Par contre, ultimement, ce sont les moins qualifiés qui s’y retrouvent puisque des plus qualifiés risquent d’occuper des emplois demandant moins de compétences spécifiques. Il faut aussi souligner que ces emplois moins qualifiés offrent généralement des conditions d’emploi moindres. L’inflation des titres scolaires et la surqualification pourraient donc être une des causes de l’appauvrissement des conditions d’emploi des jeunes au cours des dernières décennies, notamment en termes de salaires.
À long terme, les conséquences les plus troublantes de la surqualification concernent le développement des compétences des diplômés, comme le souligne Gabriel Laroche : « un mauvais aiguillage, un chômage prolongé peuvent entraîner des conséquences durables sur la mise en valeur et le développement futur des compétences du jeune travailleur », ce qu’on désigne comme le phénomène d’hystérésis. On peut aussi se demander ce qu’il advient d’un travailleur ayant occupé trop longtemps un emploi dans lequel il ne met pas à profit les compétences acquises par sa scolarité. Pourra-t-il toujours prétendre les détenir après deux ans ? Après cinq ans ? Le risque de perdre un potentiel, un « capital humain » précieux, souligne l’importance d’agir sur ces problématiques.
Les pénuries de main d’œuvre appréhendées
Comme en faisait état la section précédente, la main d’œuvre devrait se raréfier au Québec dans les années à venir. Dans un tel contexte, certains s’inquiètent de pénuries de main-d’œuvre généralisées, des pénuries d’autant plus préoccupantes si elles menacent des secteurs dynamiques du développement économique ou des services publics. Par contre, sur une note plus positive, cela pourrait bien conduire à l’amélioration des conditions générales d’emploi si la main d’œuvre se fait rare. De l’avis de plusieurs, la question des pénuries de main d’œuvre semble liée à l’amélioration de la situation des jeunes sur le marché du travail puisque qu’ils profiteraient du départ des Baby-boomers.
Déjà, des difficultés de recrutement sectorielles se font sentir. Le manque de médecins et d’infirmières dans le réseau de la santé, un sujet sensible, défraie régulièrement les manchettes. Pourtant, ces difficultés actuelles sont surtout concentrées dans des secteurs moins exigeants en termes de qualifications professionnelles. La dernière Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec (EREQ), réalisée par le CETECH [126], montre en effet que les variations positives de l’emploi, les difficultés de recrutement et les postes vacants sont tous plus fréquents pour les emplois moins qualifiés. Ces indicateurs composent le tableau 3.3.1, et démontrent que la vitalité de l’emploi concerne davantage les emplois moins qualifiés et que la croissance des emplois hautement qualifiés s’est amenuisée.
Depuis le milieu des années 90, la croissance des emplois hautement qualifiés a été spectaculaire. Mais Gabriel Laroche prévoit un « ralentissement probable de la croissance de l’emploi hautement qualifié durant les deux prochaines décennies en comparaison de ce qu’elle avait été durant les deux décennies précédentes » [127]. L’éclatement de la bulle boursière lié aux nouvelles technologies, ou encore les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, « en frappant les secteurs de haute technologie qui avaient été les moteurs de l’emploi au cours des années précédentes, ont ralenti la progression de l’emploi hautement qualifié » [128]. Pour ce qui est des prévisions de 655 000 emplois à pourvoir pour la période 2003-2007, bien que les professions hautement qualifiées représentent « 68 % des professions considérées comme ayant des perspectives d’emploi très favorables ou favorables » [129], le volume d’emploi demandant une formation collégiale technique ou universitaire ne représente que 35 % de ces 655 000 emplois.
Outre le ralentissement de la croissance de l’emploi hautement qualifié, le CETECH évalue que le Québec n’a pas à craindre de pénuries généralisées de main d’œuvre ayant une formation postsecondaire. Divers facteurs et possibilités d’ajustement concourent à ce diagnostic optimiste, que nous résumons ici :
• Les craintes de pénurie ou les pénuries actuelles reposent sans doute sur la vigueur de l’emploi, dont une bonne part n’est que conjoncturelle ;
• Il est probable que le taux de participation des femmes adultes continue d’augmenter compte tenu de leur scolarité élevée, comme on l’a vu plus tôt, contrebalançant la diminution de la population active ;
• Les retraites chez les femmes pourraient être moins nombreuses en général ;
• Les hommes de 55 ans et plus ont aussi le potentiel de faire augmenter leurs taux d’activité et d’emploi, surtout chez les travailleurs hautement qualifiés dont le travail est moins physique qu’intellectuel ;
• Les immigrants reçus au Québec représentent un bassin de travailleurs hautement qualifiés, mais qui est sous-employés à cause de difficultés d’insertion. Si celles-ci s’atténuent, leur participation au marché du travail s’en trouvera accrue ;
• Les perspectives de croissance sont nulles ou très faibles pour la fonction publique, qui emploie un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés ;
• Les jeunes surqualifiés pour les emplois qu’ils occupent présentement forment, de l’avis des auteurs du CETECH, un bassin de main d’œuvre qualifiée et disponible. Le phénomène d’hystérésis pourrait toutefois jouer en défaveur de cette hypothèse.
Suivant l’analyse du CETECH, il est possible que les conditions d’emploi de certains jeunes hautement qualifiés mais sous-employés soient améliorées dans les années à venir. Par contre, les pénuries de main-d’œuvre ne semblent pas à prévoir, du moins pas à grande échelle.
En terminant, si certains voyaient dans la raréfaction de la main d’œuvre une voie d’amélioration des conditions d’emploi des jeunes, quelques éléments nous en font douter. Nous avons vu que malgré la raréfaction de la relève, avec le déclin démographique déjà présent des groupes d’âge les plus jeunes, les conditions d’emploi de ces groupes d’âge ne se sont pas améliorées, au contraire. Elles se sont détériorées et notamment en raison de leur âge. La précarité des emplois et la diminution des salaires réels l’attestent. La diminution de la main-d’œuvre pourrait inciter les employeurs à d’autres stratégies que le renouvellement par l’embauche, comme la rationalisation des effectifs par attrition pour citer un exemple tiré de la fonction publique québécoise. Pour ces raisons, et quoique certains jeunes puissent tirer profit des départs à la retraite, il est permis de douter que les tendances dans le marché du travail soient à l’avantage des jeunes dans leur ensemble.
3.4 Conclusion
Malgré la diversité des facteurs à l’œuvre dans le marché du travail québécois, certaines tendances de fond ressortent clairement du lot et permettent en partie de distinguer quelques perspectives futures en dépit d’une conjoncture économique teintant favorablement la situation actuelle. Le déclin démographique ressort comme la première de ces tendances. Il influence déjà le marché du travail et ses impacts augmenteront au cours des ans.
La féminisation du marché du travail a toutes les chances de continuer puisque les jeunes femmes auront sans doute des taux d’activité et d’emploi plus élevés que les générations précédentes. Néanmoins, le rythme de cette seconde tendance va en diminuant. Les jeunes, pour leur part, vivent une situation plus problématique. Alors même qu’ils diminuent en nombre et en proportion de la population, leurs conditions d’emploi se sont malgré tout détériorées. Et si le vieillissement de la main-d’œuvre nuit effectivement à l’intégration des nouveaux venus sur le marché du travail, les années à venir seront encore difficiles pour eux. Enfin, les diplômés universitaires pourraient aussi vivre des difficultés à moins que l’emploi correspondant à leur niveau de scolarité ne progresse significativement.
Les tendances de l’emploi liées à la scolarité, montrent d’une part que la valeur de la scolarité est à la baisse et d’autre part que nombreux sont les diplômés qui occupent un emploi se situant sous leur niveau de compétence. En effet, le même diplôme qu’autrefois n’apporte plus les mêmes avantages. Les titres scolaires perdent donc de la valeur. Ils ne garantissent pas non plus un emploi correspondant aux compétences acquises aux diplômés. Enfin, malgré les départs à la retraite, il n’est pas certain que les conditions futures du marché du travail viennent améliorer les perspectives et les conditions d’emploi des jeunes.
Constats et recommandations
L’insertion professionnelle et les conditions d’emploi des jeunes ont principalement été décrites dans ce rapport sous l’angle économique. Elles ont aussi des impacts psychosociaux qu’il ne faut pas oublier. Le chômage, la précarité, la surqualification génèrent des situations déplaisantes, insécurisantes, voire souffrantes pour ceux qui les vivent.
L’insertion professionnelle et les conditions d’emploi des jeunes ont aussi des impacts collectifs, touchant la société dans son ensemble. La condition des jeunes d’aujourd’hui concerne non seulement la société actuelle, mais aussi les décennies à venir. La démographie du Québec ne fait qu’amplifier les conséquences collectives des difficultés vécues présentement par les jeunes. Le développement économique, l’état des finances publiques, le maintien de services sociaux accessibles et de qualité dépendent tous de la contribution actuelle et future de la jeunesse québécoise. De même, les programmes qui viennent en aide aux jeunes se répercuteront sur la situation future de tous.
La conclusion de cette étude sur les perspectives et conditions d’emploi chez les jeunes est certainement que les jeunes ne se trouvent pas collectivement dans une situation idéale en matière d’emploi. Bien entendu, certains s’en sortent très bien alors que d’autres vivent des conditions d’extrême précarité. Ceci dit, l’analyse des tendances passées et à venir nous permet de poser cinq constats importants sur lesquels il convient d’agir rapidement.
1. Le décrochage scolaire est toujours trop élevé
Avec l’avènement d’une société fondée sur le savoir, la scolarité représente un outil de plus en plus essentiel pour l’insertion professionnelle et pour la vie en société. Comme nous le soulignions à la section 1.1, le décrochage scolaire devient qualitativement plus problématique dans un tel contexte. La diplomation, et la qualification qu’elle représente, doivent être améliorées. En fait, l’élévation de la scolarité semble un facteur structurant suffisamment puissant à long terme pour contrebalancer en bonne partie les effets économiques du déclin démographique.
Le décrochage au secondaire représente naturellement la première cible d’action. Il s’agit d’une qualification dont presque personne ne pourra bientôt plus se passer. La diplomation au secondaire influence aussi les taux d’accès aux études postsecondaires. Bien des moyens peuvent êtres déployés que nous n’énumérerons pas ici. Par contre, quelques pistes de solutions ont été abordées plus ou moins directement dans ce rapport qui méritent d’être rappelées.
• Les élèves qui travaillent sont plus nombreux. Il pourrait être judicieux de trouver des arrangements pragmatiques entre l’école et son milieu, notamment les employeurs. On ne peut pas se permettre de nier la réalité du travail étudiant ; on se doit par contre de minimiser ses effets potentiellement négatifs sur la réussite scolaire et la persévérance.
• Les jeunes qui décrochent devraient être systématiquement suivis suite à leur décrochage. Ce suivi pourrait être effectué par le Carrefour jeunesse-emploi le plus près, lui-même avisé par l’école que fréquentait le jeune auparavant. Une telle méthode permettrait une véritable continuité dans les services offerts aux jeunes.
• Le sentiment d’appartenance des élèves envers leur école pourrait être stimulé en améliorant le milieu de vie qu’est l’école.
• Les transferts d’élèves du secteur jeune à l’éducation des adultes démontrent peut-être que le secteur jeune doit pouvoir mieux s’adapter aux réalités des jeunes et à leurs besoins sur le plan de l’apprentissage. Ceci suppose aussi de donner à l’école des ressources pour le faire.
• Enfin, les pistes de solutions qui seront mises de l’avant devront prendre en compte les disparités régionales, et même les réalités locales, en permettant aux différents milieux de se mobiliser autour d’objectifs de réussite scolaire, de qualification et de persévérance. Il en va de même pour les réalités parfois différentes des jeunes hommes et celles des jeunes femmes.
Le décrochage affecte aussi l’éducation postsecondaire, jusqu’aux niveaux de scolarité les plus élevés. Là aussi, le décrochage signifie que l’investissement dans une formation est perdu, faute d’avoir été mené à terme. Si on souhaite collectivement améliorer les taux d’accès au collégial et à l’université, il ne faut pas négliger les difficultés des étudiants postsecondaires. Cet enjeu est d’autant plus pressant que le nombre de jeunes diminue déjà dans la population, et que les diplômés risquent de se faire plus rares alors même que ce sont encore les emplois qualifiés qui connaissent la plus forte croissance.
2. Le taux de chômage des jeunes demeure préoccupant
Cette situation reflète une tendance présente de longue date. On ne doit pas pour autant s’habituer à voir des taux de chômage systématiquement plus élevés chez les jeunes. Et bien qu’il soit plus bas depuis ces dernières années, l’embellie ne doit pas faire oublier le problème structurel du chômage des jeunes. La scolarité, dont nous venons de traiter, demeure le moyen par excellence de combattre ce chômage. Par ailleurs, l’accumulation d’une expérience professionnelle significative constitue l’autre facteur d’importance sur lequel il est possible d’agir.
• Pour les diplômés du secondaire, les étudiants postsecondaires ou encore les étudiants ayant besoin d’orientation, des insertions en entreprise et des stages pourraient être offerts. Les employeurs devraient être incités par un moyen efficace à offrir des places pour ces programmes, possiblement par le biais de la fiscalité. On pourrait penser qu’en relevant le pourcentage de la masse salariale allouée à la formation (l’actuelle taxe du 1 %), et en admettant les dépenses liées aux stages, le gouvernement pourrait créer un incitatif suffisant. Puisque les employeurs eux-mêmes bénéficieraient grandement d’une main d’œuvre plus expérimentée dans l’avenir, leur contribution serait tout à fait légitime. De plus, on peut considérer l’incidence potentiellement positive de l’expérience professionnelle sur la réussite et la persévérance scolaire ainsi que sur les futures conditions d’emploi des jeunes, comme le lien formation-emploi, les salaires et la diminution de la surqualification. Cette avenue mettrait à profit le travail étudiant en comblant les besoins financiers tout en permettant d’acquérir la précieuse expérience qui fait si souvent défaut aux jeunes.
3. Les conditions d’emploi des jeunes sont de plus en plus précaires
Le travail atypique, ayant connu une croissance importante au cours des dernières décennies, engendre une précarité proportionnellement plus importante chez les jeunes. De la part des jeunes, « l’incertitude est jugée acceptable lorsqu’on démarre dans la vie active mais elle devient plus difficile à supporter lorsqu’elle se prolonge » [130]. Cette tendance relativement récente semble refléter une profonde mutation du marché du travail qui pourrait persister ou même s’amplifier dans l’avenir. Si l’on se veut pragmatique, on ne peut penser faire disparaître complètement l’emploi atypique. Il n’est même pas sûr que cela serait souhaitable. Il faut donc s’y adapter. Cependant, la réalité de la précarité doit certainement être prise en compte afin d’épauler les jeunes dans une perspective leur permettant d’y faire face le mieux possible.
• Les lois du travail, principalement des normes du travail, doivent être modifiées pour prendre en compte cette réalité.
• Les assurances sociales qui sont accessibles par le biais de l’emploi devraient être disponibles aux travailleurs atypiques et leur accès simplifié. L’assurance-emploi est un exemple de programme dont l’accès est dénié à bien des travailleurs atypiques. L’assistance-emploi (aide sociale) du Québec devrait aussi être accessible à ces travailleurs sans tracasserie indue qui rallonge les délais d’obtention de l’aide financière alors que les jeunes n’ont souvent pas les moyens d’attendre.
4. Les gains salariaux réels et relatifs des jeunes ont décru
Ce constat inquiétant constitue un problème d’autant plus épineux que ses causes demeurent obscures, à notre avis. Par contre, si ses causes sont incertaines, les conséquences en sont plus claires et supportent la conclusion générale de cette étude selon laquelle les jeunes ont besoin de soutien. Il est toutefois possible que les jeunes aient des attentes trop faibles sur le marché du travail, ou qu’ils ne sachent pas négocier convenablement leurs conditions d’emploi. On a déjà cité Serge Paugam qui accrédite la thèse des attentes trop basses, affirmant qu’à leur point de vue, « l’essentiel étant (…) de faire leurs preuves et de se faire reconnaître par leur employeur afin de conserver le poste qu’ils occupent » [131]. Que ce soit leurs attentes ou leurs talents de négociateurs, dans tous les cas, les jeunes devraient recevoir une information adéquate sur le marché du travail et sur les stratégies à adopter avant et après l’embauche.
5. L’inflation des titres scolaires et la surqualification érodent les perspectives professionnelles des jeunes diplômés
Les diplômés postsecondaires se débrouillent mieux que les jeunes sans qualification particulière. Les tendances actuellement à l’œuvre sur le marché du travail ne les épargnent pas pour autant et font diminuer la valeur de leur scolarité. Qui plus est, par effet d’entraînement, l’inflation des titres scolaires et la surqualification affectent tous les jeunes. Il ne faut pas que la valeur professionnelle de la scolarité diminue jusqu’à ce que les futurs étudiants ne voient plus l’intérêt d’étudier. Cela pourrait se produire si les bénéfices de la scolarité s’amenuisent par rapport aux coûts assumés par les étudiants.
• La stratégie pouvant produire des résultats le plus rapidement en la matière est de réduire les coûts de l’éducation qui sont assumés par les étudiants, soit par le biais de l’aide financière aux études, soit en diminuant les frais imposés aux étudiants collégiaux et universitaires, ou encore en leur donnant accès à des stages rémunérés durant leurs études, améliorant ainsi leur condition financière.
• À moyen terme, une seconde stratégie consisterait à augmenter la qualité de l’éducation postsecondaire pour rehausser la valeur des diplômes sur le marché du travail. Dans ce cas, il faudra non seulement hausser la qualité effective de la formation, mais aussi accroître la perception de qualité auprès de plusieurs publics pour que cette solution ait des impacts concrets. Les futurs étudiants, de même que les étudiants actuels, doivent être visés pour les inciter à s’inscrire ou à poursuivre leurs études, sachant qu’elles seront de qualité. Les parents des étudiants forment aussi un public à sensibiliser puisqu’ils conseillent et supportent leurs enfants dans leur décision de s’instruire. Enfin, la confiance des employeurs dans les diplômes doit être suffisante pour créer un effet réel susceptible de diminuer la surqualification et l’inflation des titres scolaires.
• Enfin, à long terme, il faut augmenter la demande de diplômés sur le marché du travail. Cette demande doit s’accroître davantage pour offrir suffisamment d’opportunités pouvant améliorer le sort des travailleurs surqualifiés, comme le souligne justement Gabriel Laroche, du CETECH : « En matière de politiques du marché du travail, la suréducation (surqualification) fait ressortir l’importance au plan macroéconomique d’une politique d’expansion soutenue de l’emploi qui crée les opportunités suffisantes pour les plus qualifiés, relâchant ainsi la pression vers l’exclusion pour les moins qualifiés qui peuvent continuer d’avoir accès aux emplois qui correspondent normalement à leur niveau de compétences. Au plan microéconomique, la suréducation souligne l’importance des programmes d’information sur le marché du travail et de soutien à l’insertion professionnelle des nouveaux diplômés. Tout ce qui favorise une meilleure orientation ainsi qu’une insertion professionnelle optimale et rapide est important pour les nouveaux venus sur le marché du travail » [132]. Le Québec devrait à cet égard se doter d’une politique industrielle encourageant les secteurs à main-d’œuvre hautement qualifiée. Une telle politique servira aussi à tirer parti de la mondialisation des échanges et à positionner l’économie québécoise pour l’avenir.
Dans le cas présent, les trois stratégies devraient être envisagées conjointement pour engendrer un effet à la fois rapide et durable. Il y a aussi lieu de considérer la situation des immigrants surqualifiés, représentant un véritable bassin de travailleurs sous-employés. Leur situation ne peut qu’avoir des effets importants sur l’ampleur de la surqualification au Québec.
En guise de conclusion : des « clauses orphelins » systémiques ?
Le portrait que trace ce rapport n’est certes pas réjouissant. Il est en fait fort différent de ce à quoi nous nous attendions en entamant ce travail, alors que l’image d’une situation économique au beau fixe nous est constamment relayée. Cette image est valable pour l’ensemble de l’économie ; elle est fausse en ce qui concerne les jeunes.
Au travers les constats dressés dans ce rapport, une constante semble se dégager. Aussi bien les fluctuations du chômage des jeunes durant les cycles économiques que leur vulnérabilité à la précarité ou aux baisses de salaires démontrent sans cesse que « les corrections de tout type se marquent ordinairement davantage chez les jeunes travailleurs » [133]. Si les travailleurs plus âgés bénéficient de meilleures conditions, c’est notamment parce que les ajustements à la baisse sur leurs conditions risquent d’avoir des impacts néfastes sur la productivité de l’entreprise et le moral de la main-d’œuvre. Il est plus simple et moins polémique de diminuer les conditions des futurs travailleurs qui n’auront jamais connu mieux. C’est le principe des clauses de disparité de traitement, dites « clauses orphelin », mais appliqué à l’ensemble du marché du travail.
Le déclin démographique, les perspectives du marché du travail pour les années à venir ainsi que les « clauses orphelins » systémiques créent un sentiment d’urgence qui appelle à l’action. Il semble tout à fait clair que, dans une perspective générale, les jeunes travailleurs d’aujourd’hui sont des plus précieux puisque leurs responsabilités professionnelles et sociales (pour ne pas dire fiscales) seront plus grandes que celles des générations précédentes. Leur situation de rareté nous amène donc à penser que le soutien aux jeunes devrait être une composante majeure de la préparation au déclin démographique déjà entamé, parce que les échecs scolaires et professionnels de chaque jeune entraînera des coûts économiques et sociaux proportionnellement plus important qu’auparavant.
Les solutions proposées ici ne sont pas exhaustives et certaines doivent d’abord être étudiées pour mieux saisir les coûts qu’elles engendreront et les bénéfices qu’on peut en espérer. Nous demeurons cependant persuadés que les cibles identifiées sont les bonnes, peu importe les moyens mis en œuvre. Et nous demeurons persuadés de la nécessité d’agir pour améliorer les perspectives et les conditions d’emploi des jeunes du Québec.
Bibliographie
AKYEAMPONG, E. 2004. « Le mouvement syndical en transition », L’emploi et le revenu en perspectives, Statistique Canada, Vol. 16, No 3 (Automne), pp.43-52. (No 75-001-XIF au catalogue)
BARIL, Guylaine. 2004. « Les pénuries généralisées de travailleurs hautement qualifiés : problème réel ou virtuel ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 6, No 2 (Automne), pp.11-17
BEAUDRY, P. et D. A. Green. 2000. « Cohort Patterns in Canadian Earnings : Assessing the Role of Skill Premia in Inequality Trends », Revue canadienne d’économique, Vol. 33, No 4 (Novembre), pp.907-36
BEAUDRY, P. et D.A. Green. 1996. Cohort Patterns in Canadian Earnings and The Skill Biased Technical Change Hypothesis, Dept. of Economics, University of British Columbia, document de travail no 97-03
BURBRIDGE, J.B., L. Mage et A.L. Robb. 2002. « The Education Premium in Canada and the US », Analyse de politiques, Vol. 28, No 2, pp.203-17
CETECH. 2004. Les travailleurs hautement qualifiés au Québec. Portrait dynamique du marché du travail, Québec, Gouvernement du Québec
CETECH et ISQ. 2004. « Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec (EREQ) », Vol. 4, No 1 (Automne)
CETECH et ISQ. 2003. « Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec (EREQ) », Vol. 3, No 1 (Automne)
CHÉNARD, Pierre, dir. 1997. L’évolution de la population étudiante à l’université. Facteurs explicatifs et enjeux, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université du Québec
CONSEIL PERMANENT DE LA JEUNESSE. 2001. Emploi atypique et précarité chez les jeunes : Une main d’œuvre à bas prix, compétente et jetable !, Québec
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. 1996. Contre l’abandon au secondaire : rétablir l’appartenance scolaire. Avis à la ministre de l’Éducation, Sainte-Foy, Gouvernement du Québec
DAVIS, S.J. Cross-Country Patterns of Change in Relative Wages, National Bureau of Economic Research (États-Unis), document de travail no 4085, 1992
FOURNIER, Geneviève, Kamel Béji et Line Croteau. 2002. « Évolution de l’insertion socioprofessionnelle de jeunes diplômés », in Diane-Gabrielle Tremblay et Lucie France Dagenais, dir., Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec
FRAPPIER, Monique. 1993. Revenus, chômage et insertion sociale des générations du Baby-boom, 1971-1986, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture
GAGNON, Marie-Claude. 2000. L’insertion socioprofessionnelle des diplômés et diplômées universitaires et le counseling d’emploi, in Geneviève Fournier et Marcel Monette, dir. L’insertion socioprofessionnelle : un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?, Québec, Les Presses de l’Université Laval
GAUTHIER, Madeleine et al. 2004. L’insertion professionnelle et le rapport au travail des jeunes qui ont interrompu leurs études secondaires ou collégiales en 1996-1997. Étude rétrospective, Québec, INRS
GAUTHIER, Madeleine et Johanne CHARBONNEAU avec la collaboration de Martine Côté, Louise Gauthier, Angèle-Anne Brouillette et Mircea Vultur. 2002. Jeunes et fécondité : les facteurs en cause. Revue de littérature et synthèse critique. INRS Urbanisation, Culture et Société, 106 pages. Disponible en format pdf.
GAUTHIER, Madeleine, dir. 2000. Etre jeune en l’an 2000, Québec, Éditions de l’Institut québécois de recherche sur la culture, Les Presses de l’Université Laval
GAUTHIER, Madeleine et Lucie Mercier. 1994. La pauvreté chez les jeunes : précarité économique et fragilité sociale, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture
GRENIER, André. 1998. Les jeunes et le marché du travail : tendances et situation récente, Emploi-Québec
KAPSALIS, C., R. Morissette et G. Picot, L’incidence de la scolarité et l’écart salarial grandissant entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés, Ottawa, Statistique Canada, 1999 (11F0019MPF No 131 au catalogue).
LAROCHE, Gabriel. 2003. « Devons-nous craindre une pénurie généralisée de main d’œuvre hautement qualifiée ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 5, No 2 (Automne), pp.1-8
LAROCHE, Gabriel. 2001. « La main-d’oeuvre surqualifiée : une question qui mérite considération », Le Bulletin du CETECH, Vol. 3, No 1 (Printemps), pp.3-8
LAROCHE, Gabriel. 2004. « Changements démographiques et flexibilité du marché du travail : y a-t-il lieu de s’en préoccuper ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 6, No 1 (Printemps), pp.1-7
MARANDA, Marie-France et Chantal Leclerc. 2000. « Les jeunes et le discours morose sur l’emploi. Perspective de la psychodynamique du travail », in Geneviève Fournier et Marcel Monette, dir. L’insertion socioprofessionnelle : un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?, Québec, Les Presses de l’Université Laval
MORISSETTE, René et Anick Johnson. 2005. Les bons emplois disparaissent-ils au Canada ?, Ottawa, Statistique Canada
MORISSETTE, R., Y. Ostrovsky et G. Picot. 2004. « Tendances des salaires relatifs des personnes très scolarisées dans une économie du savoir », dans Services Industries in a Knowledge-Based Economy (Lipsey and Nakamura, dir.), University of Calgary Press. (à paraître au printemps 2005)
MORISSETTE, René et Marie Drolet. 1999. L’évolution de la protection offerte par les pensions aux travailleurs jeunes et plus âgés au Canada, Ottawa, Statistique Canada, (11F0019MPE, No 138 au catalogue)
MORISSETTE, René.1996. La croissance de l’inégalité des revenus au Canada, Ottawa, Statistique Canada (No 96-08, 75F0002M au catalogue)
MYLES, J., G. Picot et T. Wannell. 1998. Les salaires et les emplois au cours des années 1980 : évolution des salaires des jeunes et déclin de la classe moyenne, Ottawa, Statistique Canada, document de recherche #17
PAUGAM, Serge. 2000. Le salarié de la précarité, Paris, Presses universitaires de France
PICOT, G., A. Heisz et A. Nakamura. 2001. Durée d’occupation des emplois, mobilité des travailleurs et marché du travail des jeunes dans les années 1990, Ottawa, Statistique Canada, (11F0019MPF No 155 au catalogue)
PICOT, Garnett. 1998. Le point sur l’inégalité des gains et sur la rémunération des jeunes durant les années ’90, Ottawa, Statistique Canada (11F0019MPF No 116 au catalogue)
QUÉBEC, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 2003. Portrait statistique de l’Éducation par région, Québec, Gouvernement du Québec
TREMBLAY, Diane-Gabrielle et Lucie France Dagenais, dir. 2002. Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, Ste-Foy, Les Presses de l’Université du Québec
VULTUR, Mircea, Claude Trottier et Madeleine Gauthier. 2002. « Les jeunes Québécois sans diplôme : perspectives comparées sur l’insertion professionnelle et le rapport au travail », in Diane-Gabrielle Tremblay et Lucie France Dagenais, dir., Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université du Québec
[1] Ces données proviennent de Statistique Canada, Division de la démographie, et de l’ISQ.
[2] André Grenier, Les jeunes et le marché du travail : tendances et situation récente, (Emploi-Québec, 1998), p.5
[3] Madeleine Gauthier, dir., Etre jeune en l’an 2000, (Québec : Éditions de l’Institut québécois de recherche sur la culture, Les Presses de l’Université Laval, 2000), p.11
[4] Madeleine Gauthier, Être jeune en l’an 2000, op.cit., p.12
[5] Pierre Chénard, dir., L’évolution de la population étudiante à l’université. Facteurs explicatifs et enjeux, (Sainte-Foy : Les Presses de l’Université du Québec, 1997), p.6
[6] Idem, p.8
[7] Pierre Chénard, op.cit., p.9
[8] CETECH, Les travailleurs hautement qualifiés au Québec ; Portrait dynamique du marché du travail, (Québec : Gouvernement du Québec, 2004), pp.64-65
[9] Ces données concernent l’année 2001.
[10] Conseil supérieur de l’éducation, Contre l’abandon au secondaire : rétablir l’appartenance scolaire. Avis à la ministre de l’Éducation, (Sainte-Foy : Gouvernement du Québec, 1996), p.4
[11] Le taux de sortie sans diplôme se différencie du taux de décrochage, selon Vultur et al. Alors que le premier mesure la proportion des élèves n’ayant pas obtenu de diplôme au secteur jeunes ou avant 20 ans au secteur des adultes, le taux de décrochage mesure la proportion de jeunes d’un âge donné qui ne fréquente pas l’école tout en n’ayant pas de diplôme. On devrait donc logiquement préciser l’âge auquel le taux de décrochage est mesuré.
[12] Mircea Vultur, Claude Trottier et Madeleine Gauthier, « Les jeunes Québécois sans diplôme : perspectives comparées sur l’insertion professionnelle et le rapport au travail », in Diane-Gabrielle Tremblay et Lucie France Dagenais, dir., Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, (Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 2002), p.73
[13] Id.
[14] Idem, p.74
[15] Vultur et al., op.cit., p. 76
[16] André Grenier, op.cit., p.20
[17] Conseil supérieur de l’éducation, op.cit., p.3
[18] Vultur et al, op.cit., p.73
[19] Marie-Claude Gagnon, L’insertion socioprofessionnelle des diplômés et diplômées universitaires et le counseling d’emploi, in Geneviève Fournier et Marcel Monette, dir. L’insertion socioprofessionnelle : un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?, (Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2000), p.96
[20] Geneviève Fournier, Kamel Béji et Line Croteau, « Évolution de l’insertion socioprofessionnelle de jeunes diplômés », in Diane-Gabrielle Tremblay et Lucie France Dagenais, dir., Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, (Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 2002), pp.47-70.
[21] Fournier et al., op.cit., p.57
[22] Idem, p.58
[23] Vultur et al., op.cit., pp.71-94.
[24] Serge Paugam, Le salarié de la précarité, (Paris : Presses universitaires de France, 2000)
[25] Idem, p.51
[26] Paugam, op.cit., p.51
[27] Id.
[28] Idem, p.54
[29] Fournier et al., op.cit., p.61
[30] Idem, p.62
[31] Idem, pp.60-61
[32] Idem, p.51
[33] Marie-Claude Gagnon, L’insertion socioprofessionnelle des diplômés et diplômées universitaires et le counseling d’emploi, in Geneviève Fournier et Marcel Monette, dir. L’insertion socioprofessionnelle : un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?, (Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2000), p.93
[34] Marie-France Maranda et Chantal Leclerc, « Les jeunes et le discours morose sur l’emploi. Perspective de la psychodynamique du travail », in Geneviève Fournier et Marcel Monette, dir. L’insertion socioprofessionnelle : un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ?, op.cit., p.119
[35] Id.
[36] Madeleine Gauthier, Johanne Charbonneau et al., Jeunes et fécondité : les facteurs en cause. Revue de littérature et synthèse critique. INRS Urbanisation, Culture et Société, septembre 2002, p.67
[37] Id.
[38] Id.
[39] Id.
[40] Sondage cité dans Jeunes et fécondité, op.cit., p.29
[41] Marie-Claude Gagnon, op.cit., p.93
[42] Id.
[43] Entre 1961 et 1976, le taux de chômage des femmes était inférieur à celui des hommes, vraisemblablement en raison de leur taux de participation plus faible. Avec une entrée massive sur le marché du travail, la situation s’est renversée entre 1976 et 1991. Depuis, le taux de chômage des femmes est inférieur à celui des hommes. Monique Frappier, Revenus, chômage et insertion sociale des générations du Baby-boom, 1971-1986, (Québec : Institut québécois de recherche sur la culture, 1993), p.67
[44] Idem, p.64
[45] Frappier, op.cit., p.66
[46] Un phénomène économique est décrit comme contracyclique lorsqu’il décroît en période de croissance économique et augmente en période de récession. C’est exactement le cas du chômage qui est plus élevé lorsque l’économie décroît.
[47] André Grenier, op.cit., p.9
[48] Idem, pp.9-10
[49] En effet, l’étude d’André Grenier a été publiée en 1998.
[50] Les proportions des jeunes travaillant dans une industrie par rapport aux jeunes présent dans le secteur des services n’est pas tiré du tableau puisque ce dernier présente le pourcentage de jeunes dans l’ensemble des 15 ans et plus. Elles sont toutefois calculées avec les mêmes séries de données bien qu’elles ne soient pas présentées au tableau 1.3.4.
[51] Québec, Secrétariat du Conseil du trésor, L’effectif de la fonction publique du Québec, 2003-2004 ; Analyse comparative des cinq dernières années, [www.tresor.gouv.qc.ca/effectif], 2005, p.18
[52] Idem, p.24
[53] Madeleine Gauthier, La pauvreté chez les jeunes ; précarité économique et fragilité sociale, (Québec : Institut québécois de recherche sur le culture, 1994), pp.95-96
[54] Madeleine Gauthier, La pauvreté chez les jeunes, op.cit, p.97
[55] Idem, p.101
[56] Idem, p.102
[57] Madeleine Gauthier, La pauvreté chez les jeunes, op.cit., p.89
[58] Id.
[59] QUEBEC, Conseil permanent de la jeunesse, Emploi atypique et précarité chez les jeunes : Une main d’œuvre à bas prix, compétente et jetable !, Québec, 2001.
[60] Introduction de Diane-Gabrielle Tremblay dans Diane-Gabrielle Tremblay et Lucie France Dagenais, dir., Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, (Ste-Foy, Québec : Les Presses de l’Université du Québec, 2002), p.16
[61] Ces chiffres proviennent de Statistique Canada et ne concernent pas uniquement le Québec mais bien le Canada dans son ensemble.
[62] Gouvernement du Québec, Ministère du travail, “L’évolution du marché du travail atypique au Québec”, encart dans Le marché du travail, vol. 19, no 5, p.25, cité dans Conseil permanent de la jeunesse, op. cit., p.23
[63] Conseil permanent de la jeunesse, op. cit., p.26
[64] André Grenier, op.cit., p.12
[65] Conseil permanent de la jeunesse, op.cit., p.24
[66] Id.
[67] André Grenier, op.cit., p,13
[68] Conseil permanent de la jeunesse, op.cit., p.25
[69] André Grenier, op.cit., p.13
[70] André Grenier, op.cit., p.14
[71] Construit avec des données compilées par Emploi-Québec, il ne donne pas les types de travail temporaire, mais les groupes d’âge représentés sont plus précis, notamment avec la séparation entre les 15-19 ans et les 20-25 ans, et il illustre les données de l’année 2004.
[72] André Grenier, op.cit., pp.15-16
[73] CPJ, op.cit., p.35
[74] idem, p.37
[75] Idem, p.38
[76] G. Picot, A. Heisz et A. Nakamura, Durée d’occupation des emplois, mobilité des travailleurs et marché du travail des jeunes dans les années 1990, Ottawa, Statistique Canada, 2001 (11F0019MPF No 155 au catalogue), p.28
[77] Monique Frappier, op.cit., p.14
[78] L’étude en question est celle de Finis Welch, Minimum wages, Issues and Evidence, (Washington : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978).
[79] J. Myles, G. Picot et T. Wannell, Les salaires et les emplois au cours des années 1980 : évolution des salaires des jeunes et déclin de la classe moyenne, (Ottawa : Statistique Canada, juillet 1988), document de recherche #17, p.34
[80] Idem, p.79
[81] Idem, p.78
[82] Morissette et Johnson, Les bons emplois disparaissent-ils au Canada ?, (Ottawa : Statistique Canada, 2005).
[83] Morissette et Johnson, op.cit., p.7
[84] Idem, p.11
[85] René Morissette, La croissance de l’inégalité des revenus au Canada, Ottawa, Statistique Canada, 1996. (No 96-08, 75F0002M au catalogue)
[86] Garnett Picot, Le point sur l’inégalité des gains et sur la rémunération des jeunes durant les années ’90, Ottawa, Statistique Canada, 1998, p.3. (11F0019MPF No 116 au catalogue)
[87] Idem, voir les pages 23-24
[88] S.J. Davis, Cross-Country Patterns of Change in Relative Wages, National Bureau of Economic Research, document de travail no 4085, 1992.
[89] Garnett Picot, Le point sur l’inégalité des gains…, op.cit., p.29
[90] Id.
[91] Idem, p.93
[92] Id.
[93] Madeleine Gauthier et Lucie Mercier, La pauvreté chez les jeunes : précarité économique et fragilité sociale, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, p.94
[94] P. Beaudry et D.A. Green, Cohort Patterns in Canadian Earnings and The Skill Biased Technical Change Hypothesis, Dept. of Economics, University of British Columbia, document de travail no 97-03, 1996, cité dans Garnett Picot, op. cit., p.29
[95] C. Kapsalis, R. Morissette et G. Picot, L’incidence de la scolarité et l’écart salarial grandissant entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés, Ottawa, Statistique Canada, 1999 (11F0019MPF No 131 au catalogue).
[96] Garnett Picot, op.cit., p.29
[97] P. Beaudry et D.A. Green, « Cohort Patterns in Canadian Earnings : Assessing the Role of Skill Premia in Inequality Trends », Revue canadienne d’économique, Vol. 33, No 4, novembre 2000, citée dans l’avis du CPJ, op.cit., p.39
[98] René Morissette et Marie Drolet, L’évolution de la protection offerte par les pensions aux travailleurs jeunes et plus âgés au Canada, Ottawa, Statistique Canada, 1999 (11F0019MPE, No 138 au catalogue), p.12
[99] Id.
[100] Morissette et Johnson, op.cit., p.22
[101] Morissette et Johnson, op.cit., p.16
[102] E. Akyeampong, « Le mouvement syndical en transition », L’emploi et le revenu en perspectives, Statistique Canada, Vol. 16 No 3, automne 2004, pp.43-52. (No 75-001-XIF au catalogue).
[103] André Grenier, op.cit., p.15
[104] André Grenier, op.cit., p.15
[105] Myles, Picot et Wannell, op.cit., p.75
[106] Introduction de Diane-Gabrielle TREMBLAY dans Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, op.cit., p.20
[107] Ces données sont tirées des Principaux indicateurs économiques publiés sur le site Internet de l’ISQ,www.stat.gouv.qc.ca/princ_indic/default.htm, page consultée le 28 juillet 2005.
[108] Centre d’étude sur les niveaux de vie,www.csls.ca/data/ptabln/t1-qc-june13-05.pdf, page consultée le 28 juillet 2005.
[109] On peut considérer que les Baby-boomers sont nés entre 1946 et 1966, ce qui signifie qu’ils sont aujourd’hui âgés entre 40 et 60 ans.
[110] Les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec comprennent plusieurs scénarios. Les données présentées ici sont toutes tirées du Scénario A, dit scénario de référence.
[111] Il faut noter que la Côte-Nord et le Nord-du-Québec ont été amalgamés.
[112] Gabriel Laroche, « Changements démographiques et flexibilité du marché du travail : y a-t-il lieu de s’en préoccuper ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 6, No 1 (Printemps 2004), pp.1-2 (l’italique a été ajouté)
[113] CETECH, Les travailleurs hautement qualifiés au Québec. Portrait dynamique du marché du travail, (Québec : Gouvernement du Québec, 2004), p.71
[114] Définie brièvement, la main d’œuvre hautement qualifiée est celle qui détient un diplôme collégial technique ou une formation universitaire. Les emplois hautement qualifiés sont ceux qui demandent de telles qualifications.
[115] CETECH, Les travailleurs hautement qualifiés au Québec. Portrait dynamique du marché du travail, op.cit., pp.113-117
[116] Idem, p.70
[117] Monique Frappier, op.cit., p.87
[118] Fournier et al., op.cit., p.51
[119] Id.
[120] Monique Frappier, op.cit., p.21
[121] Fournier et al., op.cit., p.52
[122] Statistique Canada, Le point sur la population active, Les jeunes et le marché du travail, no 71-005-XPB, printemps 1997, p.15, cité dans l’avis du CPJ, op.cit., p.38
[123] Fournier et al., op.cit., p.52
[124] Gabriel Laroche, « La main d’oeuvre surqualifiée : une question qui mérite considération », Le Bulletin du CETECH, Vol. 3, No 1 (Printemps 2001), pp.3-8
[125] Idem, p.5
[126] CETECH et ISQ, « Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec (EREQ) », Vol. 4, No 1 (Automne 2004)
[127] Gabriel Laroche, « Devons-nous craindre une pénurie généralisée de main d’œuvre hautement qualifiée ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 5, No 2 (Automne 2003), p.4
[128] Guylaine Baril, « Les pénuries généralisées de travailleurs hautement qualifiés : problème réel ou virtuel ? », Le Bulletin du CETECH, Vol. 6, No 2 (Automne 2004), p.12
[129] Idem, p.13
[130] Fournier et al., op.cit., p.53
[131] Serge Paugam, op.cit., p.51
[132] Gabriel Laroche, La main d’œuvre surqualifiée, op.cit., p.8
[133] Garnet Picot, Le point sur l’inégalité des gains et sur la rémunération des jeunes durant les années ’90, op.cit., p.29
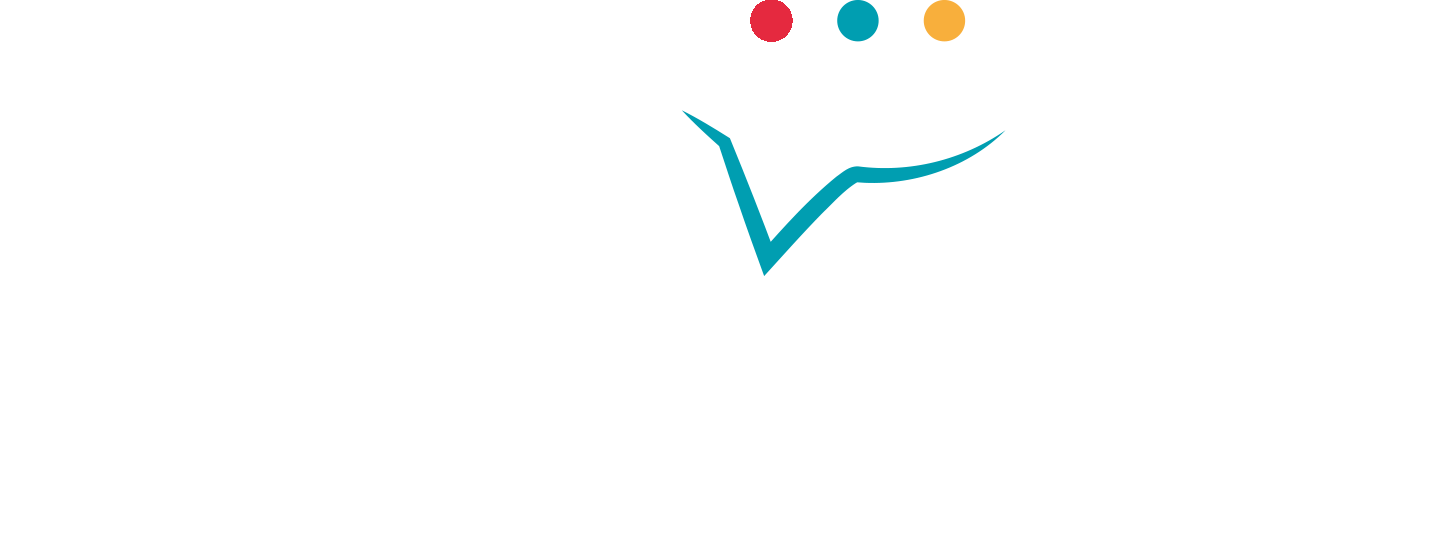




 Téléchargez la version PDF
Téléchargez la version PDF